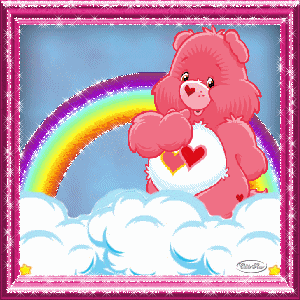mercredi 28 mai 2008
20 ans n'est peut-être pas le plus bel âge, mais le plus clairvoyant
Par admin, mercredi 28 mai 2008 à 22:37 :: Littérature française

Gallimard vient de publier les Cahiers de Jeunesse (1926-1930) de Simone de Beauvoir, qu'elle a rédigés de 18 à 22 ans... Talent impressionnant ! Des centaines de pages, déjà, parfaitement fluides et savoureuses, constamment tendues par l'exigence d'accomplir son oeuvre et d'accomplir sa vie. Le plus frappant, c'est la constance des obsessions tout au long de sa carrière, celles-là même qu'on retrouvera dans les Mémoires d'une jeune fille rangée - comme le souci de la transparence.
Quand elle réfléchit au mariage, elle se dit prête à franchir le pas, mais à la seule condition de ne pas soumettre son propre épanouissement à celui de son époux. Ni d'y sacrifier son honnêteté... On dirait les termes mêmes de son futur contrat avec Sartre !
"Un mois déjà que j'ai quitté Paris ; quinze jours que je suis ici. J'aime ces longs après-midi qu'il m'est permis de passer dans un recueillement oisif ; les jours de spleen, c'est dur parce que rien ne vient faire diversion. Mais les jours de lucidité calme, quelle détente saine ! Pouvoir enfin sans être pressée par un travail, gênée par une présence importune, épuiser tous mes sentiments ; ne plus rien étouffer, mais se livrer au caprice des émotions. Si seulement j'avais des livres, j'entends de ces livres qui sont des amis et des maîtres !" (p 69)
On dirait toute sa vie future dans une poignée d'intuitions précoces.
La proximité avec Sartre est également frappante, avant même que la rencontre ait eu lieu, et cela dès les premières pages : le paragraphe suivant, le tout premier du volume, ressemble à s'y méprendre à certaines réflexions de Jean-Paul nous expliquant que La Nausée (son roman sur les troubles existentiels d'un jeune professeur...) perd toute son importance à côté d'un enfant qui meurt (je ne me souviens plus des termes exacts) :
"Devant ces malades de Lourdes, quel dégoût soudain de toutes les élégances intellectuelles et sentimentales ; que sont nos peines morales à côté de cette détresse physique ; de tout cela j'ai eu honte, et seule une vie qui fût un don complet de soi, une totale abnégation, m'a semblé possible. Je crois que j'avais eu tort ; j'ai eu honte de vivre, mais puisque la vie m'a été donnée, j'ai le devoir de la vivre, et le mieux possible."
Simone me fait l'impression d'être un Jean-Paul en moins philosophe, et donc en plus souple, en plus vivant... Y aurait-il un côté jazz chez Simone ?
En la lisant je pense également à une Colette en moins luxuriant, mais en plus prolixe, en plus universel, en plus discrètement conceptuel...