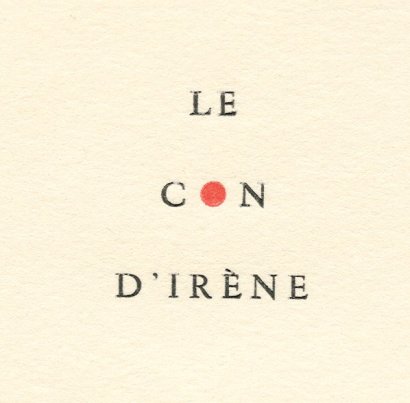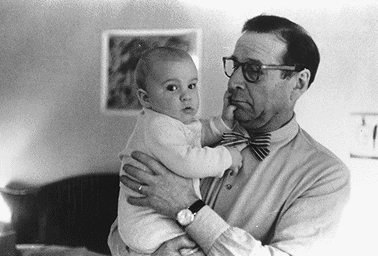J’ai du mal à trouver des livres drôles, sans tomber dans l’humour
poissard ou futile. C’est chose faite avec le dernier roman de Philippe
Jaenada,
La femme et l’ours (Grasset, 2011), que je m’étais promis de lire en découvrant le titre. Et je me suis régalé...
Dans le chapitre d’ouverture, je trouve cet excellent portrait d’un pilier de bar, Jésus. En grand fan de littérature punk (Kathy Acker, Wojnarowicz…) et en praticien d’une certaine littérature de la déglingue, je ne pouvais que tomber sous le charme de ce genre de page :
«
Il parlait souvent de la mort, qu’il estimait proche, inéluctable ou souhaitable selon les jours et les moments desdits jours (souhaitable surtout le matin), et ne vivait plus que pour deux choses : la bière et les filles. La bière, ça allait, mais les filles, des clous. Il ne pouvait rien faire d’autre que de les regarder passer, légères, jambes, seins, cul, cheveux, distantes, sur le trottoir devant le bar, sur le passage piéton, les clous, il écarquillait les yeux, bougeait spasmodiquement les bras et jurait entre ses quelques dents : elles étaient là, proches, magnifiques et moelleuses, et il ne pouvait même pas leur toucher une oreille.
La dernière avec qui il avait eu la chance de coucher s’appelait Myriam, c’était la femme de sa vie. Elle n’était plus très jeune ni très belle, elle avait une bonne trentaine de kilos en trop, elle était irascible et malade, elle boitait, criait souvent, portait une perruque – mais il l’aimait. Ils se disputaient sans cesse, à toute heure, pour des choses aussi graves qu’une cigarette, un fond de bière ou une part de pizza, ils semblaient se haïr mais ne pouvaient se passer l’un de l’autre. Un jour de printemps, elle avait un peu plus de quarante ans, elle est partie se refaire une santé dans les Alpes (ce n’était pas du luxe), où elle est morte. »
L’intrigue relativement épurée (le narrateur est un homme usé, écrivain au succès relatif, lassé de sa vie de famille, partant courir les routes pour retrouver la trace d’une conquête) donne prétexte à de nombreux épisodes picaresques. Jaenada fait preuve d’une certaine maestria dans l’humour pince sans rire et l’amertume polie. Son sens de la formule fait mouche dans les scènes de bar comme dans les récits annexes, souvent brillants, parfois dignes de scénarios pour Hollywood – comme cette histoire, au chapitre 6, d’un génial jouer de cartes persévérant à gâcher sa fortune à coups de paris malheureux sur les champs de course.
«
C’est à ce moment-là que se produit un premier glissement anormal (mais prévisible : un enfant, presque un bébé, qui se passionne ardemment et exclusivement pour les jeux de cartes à peine son doudou mis de côté, a forcément un problème – il y a toutes sortes de problèmes, graves ou bénins, utiles ou nuisibles, mais quel qu’il soit, il en a un, c’est clair comme deux et trois ne font pas quatre) : il donne mille dollars à ses parents, bon fils, et, mauvais garçon, joue et perd les neuf mille autres en une semaine sur un champ de courses. C’est moche, à quinze ans. » (page 79)
Le roman s’achève par un réjouissant bouquet final de comique pornographique, démentant l’assertion de narrateur au chapitre 5 : « La mesure est le secret de l’élégance littéraire ». Prostituée vieillissante, amant vicelard et déboires sexuels viennent clore un roman dont la morale pourrait être : « Rentrez vite à la maison, piteux hommes vieillissants… »
Trois questions à l'auteur.
1)
Philippe, le narrateur semble très proche de toi… Le terme t’agacera sans doute, mais penses-tu pratiquer une forme d’autofiction – un fond de faits réels à partir desquels broder des choses plus fantaisistes ?
Le terme ne m’agace pas du tout, c’est l’interprétation qu’on lui a donnée qui ne me plaît pas. Dans le langage courant, c’est devenu quasiment péjoratif et ça désigne, pour simplifier, « un auteur qui raconte sa vie » (sous-entendu : surtout ses mycoses entre les orteils et sa souffrance quand il a été accusé à tort d’avoir lancé un chewing-gum dans le dos du prof de maths). Mais l’autofiction, c’est de la fiction à partir de soi, de sa vie, non ? Donc c’est à peu près exactement ce que je fais (du moins jusqu’à maintenant – je vais changer, là, je n’ai plus rien à raconter, j’ai à peu près la vie d’une méduse) : je me sers de choses que j’ai vécues (ou qu’ont vécues des proches, ou que j’ai entendues – je rapine un peu partout autour) comme d’une sorte de charpente, de moelle, et ensuite je modifie, je brode, je transforme, je compose et tout le toutim. Un peu comme quand on fait fondre les bijoux de sa grand-mère pour en faire un bracelet, disons.
2) Le bar est un lieu privilégié de tes romans. T’inscris-tu dans une certaine tradition littéraire, celle qui, par exemple de Blondin à Bukowski, met en scène des buveurs et leur confère une certaine force subversive ?
Oui. Bon, d’abord, le bar est un lieu privilégié de mes romans parce que j’y passe à peu près tout mon temps libre. Pour te donner une idée : dans une journée, je reste environ vingt-et-une heures chez moi et trois au bar en bas (quand je te disais que j’avais une vie de méduse). Et puis le bar a quand même deux avantages appréciables. D’abord, c’est un des rares endroits où des gens qui ne se connaissent pas ou peu, dont toi (moi, je veux dire), se côtoient et discutent, entre eux ou pas – ce qui permet de leur parler, ou même simplement, l’air de rien, à la fourbe, de les écouter. C’est tout de même plus simple que d’aller sonner chez quelqu’un qu’on ne connaît pas en demandant si on peut s’installer dans un coin du salon, promis je ne vous dérangerai pas. L’autre avantage, bien sûr, c’est l’alcool. « In vino veritas », je ne suis pas sûr du tout, mais l’alcool, s’il n’est pas révélateur, et au moins désinhibeur, accélérateur, dynamiseur – source d’action. Dans La femme et l’ours, par exemple, si le narrateur n’avait pas fait de nombreux passages dans les bars au cours de son petit périple (comme une voiture de course fait des arrêts au stand), il n’aurait pas été propulsé de déboire en déboire (c’est intéressant, d’ailleurs, l’étymologie de ce mot), de maladresse en mésaventure, de Paris à Monaco, il serait rentré chez lui dès le lendemain matin.
3) Portes-tu sur ta carrière le même regard que Bix, ton personnage, sur la sienne ?
A peu près. Pas tout à fait. (On rejoint ce truc d’autofiction.) Je fais le même constat que lui (on se donne beaucoup de mal pour presque rien), comme lui j’aimerais avoir dix fois plus de lecteurs (mais je connais des tas d’auteurs dépités ou frustrés, perplexes et impuissants, pour ne pas dire tous : quand on a 3 000 lecteurs on se dit que ceux qui en ont 10 000 ont bien de la chance, quand on en a 40 000 on ne comprend pas pourquoi d’autres en ont 100 000, quand on est Houellebecq on est jaloux de Bret Easton Ellis – et quand on vend un million d’exemplaires on aimerait bien être aussi estimé par le « milieu », ou par ses amis, que celui qui en vend 3 000), je patauge comme lui mais ça ne m’abat pas, ne me décourage pas (je suis fort), ne me pousse pas au désespoir – du tout. Je continue à écrire et voilà. Si l’autofiction était ce qu’on entend par là, il n’aurait pas été si déprimé, il ne serait pas parti en sucette, il serait, là aussi, rentré chez lui dès le lendemain matin. Je suis rentré plein de fois chez moi dès le lendemain matin, ça ne fait pas un livre. Or l’important, c’est le livre, quand même, non ?