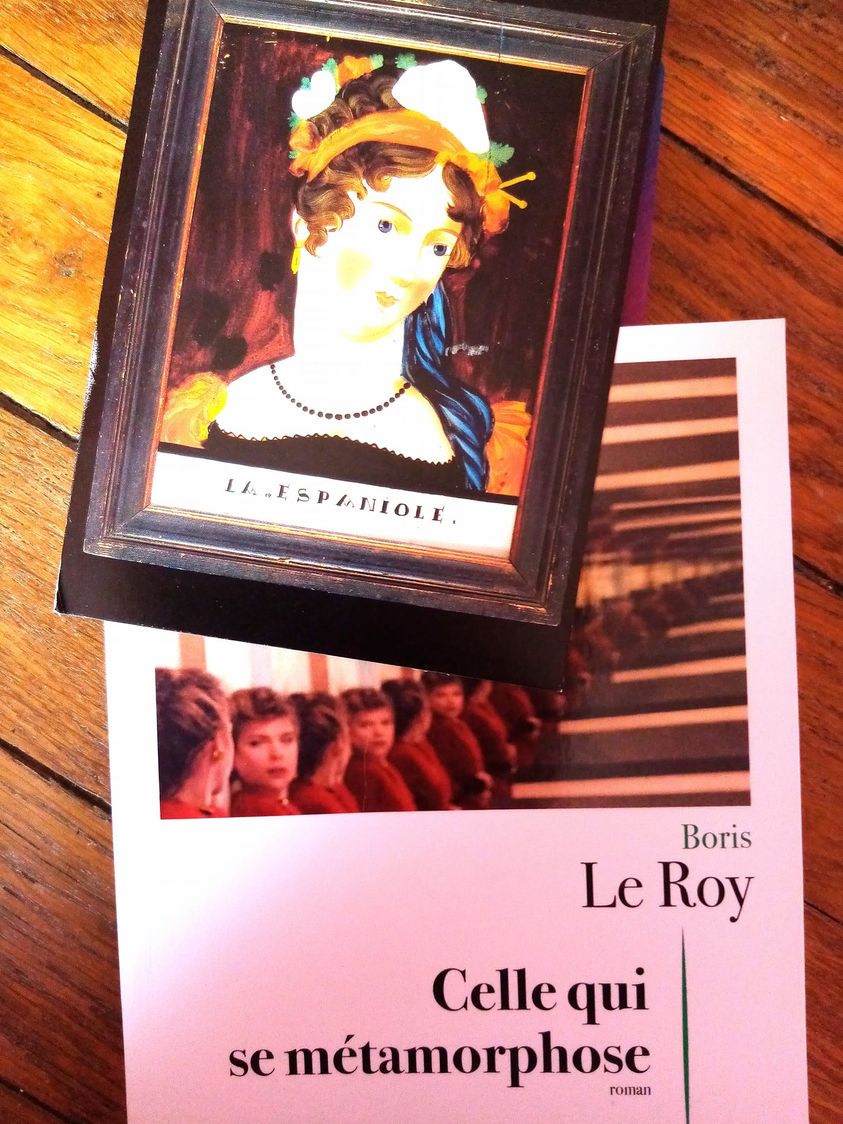mardi 19 octobre 2021
Brutalité de Pialat, brutalité de l'art
Par admin, mardi 19 octobre 2021 à 16:28 :: Cinéma/Musique/théâtre
Ironie des canaux de diffusion, c’est avec les plateformes de streaming américaines que je (re)découvre des pans entiers du cinéma classique français. Netflix m’a permis de compléter ma connaissance de la délicieuse filmographie de Jacques Demy, aujourd’hui je découvre grâce à Amazon l’intégralité de l’œuvre de Maurice Pialat.
A ce propos, je suis surpris par la grande force et, pour tout dire, par la brutalité des rapports humains que met en scène Pialat. On comprend de film en film que les protagonistes bourrus, sympathiques par leur enthousiasme mais insupportables par leur agressivité, leur façon de toujours dénigrer l’autre en des termes insultants, ressemblent sans doute au cinéaste lui-même, et c’est assez troublant. Quel plaisir y a-t-il à se plonger dans la psychologie mauvaise et tourmentée d’un créateur ? Je suis d’autant plus désarçonné que mes propres romans proposent souvent cet abord très rude, au-delà d’un style qui se veut léché . Sans doute une catharsis autant qu’un désir de se confronter à ce qu’il y a de capiteux, de radical dans toute existence humaine…

A ce propos, je suis surpris par la grande force et, pour tout dire, par la brutalité des rapports humains que met en scène Pialat. On comprend de film en film que les protagonistes bourrus, sympathiques par leur enthousiasme mais insupportables par leur agressivité, leur façon de toujours dénigrer l’autre en des termes insultants, ressemblent sans doute au cinéaste lui-même, et c’est assez troublant. Quel plaisir y a-t-il à se plonger dans la psychologie mauvaise et tourmentée d’un créateur ? Je suis d’autant plus désarçonné que mes propres romans proposent souvent cet abord très rude, au-delà d’un style qui se veut léché . Sans doute une catharsis autant qu’un désir de se confronter à ce qu’il y a de capiteux, de radical dans toute existence humaine…