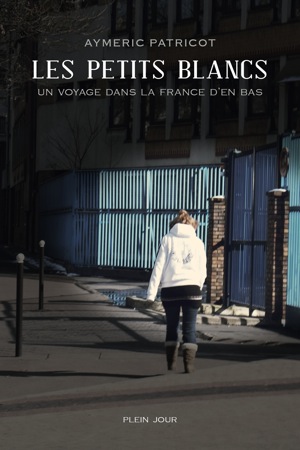Le site
Atlantico.fr m'interroge, avec d'autres, sur le thème : "Politiques, syndicats, médias : Qui comprend encore les "vrais gens" ?
Invité dans "Des paroles et des actes", Jean-François Copé a été violemment pris à partie par Isabelle Maurer, une demandeuse d'emploi de Mulhouse (voir ici). "Je suis désolée Monsieur Copé, ce soir je ne peux pas être calme", a commencé la femme. Et de poursuivre : "Les Français vous regardent. Ils vous écoutent. Et malheureusement il y a beaucoup de paroles et pas beaucoup d'actes !". Déstabilisé, le président de l'UMP n'a pas su quoi répondre. Au-delà de cette séquence et de la gêne de Jean-François Copé qui aurait pu réellement comprendre et répondre aux questions d'Isabelle Maurer ?
Jean Spiri : Mais que voulez-vous répondre ? Qui aurait pu répondre ? Aucun élu national ne vit cette réalité de tenter de vivre avec le RSA socle en cherchant du travail – aucun élu national, car la situation des élus locaux est très variée, et il ne faut pas oublier les milliers d’élus locaux qui exercent leur mandat bénévolement. Mais beaucoup – voire tous – y ont été confrontés, dans leurs fonctions d’élu local, lors de leurs permanences. Une situation comme celle-ci ne peut laisser insensible. Un élu local a des solutions particulières, mais un élu national se doit de proposer des solutions générales. C’est le problème de confronter des responsables politiques à des interventions de ce type : soit ils restent dans le pathos et ne peuvent rien dire, car oui, ils ne vivent pas cette situation, soit ils proposent des solutions qui sont sans commune mesure avec la détresse de leur interlocuteur immédiat. Cela n’est ni de droite ni de gauche : on se souvient de Christiane Taubira confrontée à la mère d’une victime d’un multirécidiviste. Que voulez-vous répondre face à une telle douleur ? Le responsable politique qui répondra en généralité paraîtra froid, insensible, technocratique ; cela qui répondra sur le registre personnel paraîtra déconnecté et démuni, sans réponse.
Mais nous ne devons pas nous arrêter à ce niveau d’analyse. Premièrement, il y a en effet des propositions systémiques pour répondre à un cas particulier. J’irai même plus loin : ce sont souvent des décisions macroéconomiques qui changent, sur le long terme, les destins individuels. Mais qu’il est difficile de faire comprendre que telle ou telle mesure représentera demain de l’emploi en plus, du pouvoir d’achat en plus, si l’on n’est pas capable de répondre à l’urgence d’une situation. Deuxièmement, il y a, comme l’a rappelé Jean-François Copé, des élus, qui eux accomplissent un vrai travail de développement territorial, de solidarités locales. Ce n’est pas un hasard si, malgré la baisse globale de la cote des élus, c’est encore le maire qui inspire le plus confiance à nos concitoyens. Enfin, je rappelle que le cas particulier est toujours dangereux pour l’analyse globale (désolé pour ceux qui voulaient une réponse dans le pathos). Je prendrais un seul exemple : aujourd’hui, le niveau de vie des retraités dépasse celui des actifs. C’est inédit. Mais chaque fois que vous le rappellerez, vous aurez aussitôt l’exemple de la veuve de marin-pêcheur fort mal lotie qui surgira. C’est vrai, il faut le prendre en compte. Est-ce une raison pour balayer d’un revers de manche tout discours général sur un rééquilibrage entre les générations (avec par exemple l’alignement de la CSG) ? Je ne le crois pas. Mais face à la veuve qui a une petite pension de réversion, que ce discours devient dérisoire et difficile à entendre ! Dans une certaine mesure, ce type de procédés empêche le débat de fond, celui de l’intérêt général qui transcende la somme des intérêts particuliers – même s’il ne doit pas oublier les cas concrets !
Raphaël Liogier (auteur de Ce populisme qui vient, Textuel, septembre 2013) : Il me semble que la vraie question n’est pas qui aurait pu répondre, mais quoi répondre. Si la plupart des hommes politiques, et non seulement Jean-François Copé, peuvent être paralysés par ce genre d’intervention de "simples citoyens", c’est qu’ils ont fondé toute leur tactique politique sur l’empathie. En réalité ils ne sont pas plus éloignés de la vie populaire que les hommes politique de jadis, parce que c’est le principe même du pouvoir politique de créer une distance. La spécificité de notre époque, c’est qu’il y a une crise du récit collectif, et corrélativement une perte de confiance non seulement dans la politique en tant que telle mais dans le sens du vivre ensemble.
Une telle situation se traduit par le développement du populisme : une sorte de politique de l’empathie, vide de tout programme, qui cherche sans cesse à suivre les courants d’une opinion versatile. En réalité, cette façon de faire de la politique est la véritable trahison des aspirations populaires profondes. C’est ce que Baudrillard appelait la "politique du signe" : les dirigeants ne cherchent plus à faire sens, mais à montrer au peuple qu’ils comprennent leurs angoisses, qu’ils les éprouvent aussi. Ils vont même faire des lois, prendre des mesures qui ne seront destinées qu’à faire signe et non pas à faire sens, non pas à résoudre un problème réel.
Copé a été pris au dépourvu parce que cette femme le met face à ses contradictions, autrement dit face au fait évident qu’il ne peut pas ressentir ce qu’elle ressent, tout simplement parce qu’il fait partie d’un autre monde. Et s’il n’avait pas été populiste, entière voué à la politique du signe, mais authentiquement politique, à mon avis il aurait dû répondre : "oui, tout à fait je ne ressens pas ce que vous ressentez, et je ne cherche pas à le ressentir, ce serait hypocrite de ma part de prétendre le contraire. En revanche, je défends un programme politique que j’entends appliquer sans me laisser distraire si j’arrive au pouvoir, y compris sans me laisser distraire parce que vous ressentez à l’instant, justement pour qu’un jour vous vous sentiez durablement mieux".
La suite du triple entretien ici :
[...]