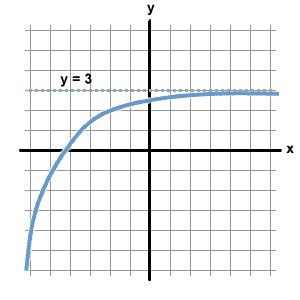dimanche 30 novembre 2008
La politique des polars (Mankell et la soupe suédoise)
Par admin, dimanche 30 novembre 2008 à 21:26 :: Littérature étrangère
Il est assez fréquent de pouvoir classer les polars dans un bord politique : la personnalité des "méchants", notamment, renseigne assez bien sur les détestations et les phobies de l'auteur. S'agit-il de redoutables capitalistes prêts à toutes les manipulations pour un coup juteux ? De crapules pourries jusqu'à la moëlle, venant de la rue, irrécupérables pour la société ? Dites-moi les ennemis que vous mettez en scène, je vous dirai pour qui vous votez...
Je viens cependant de finir un Henning Mankell (la star du polar suédois) qui n'a pas manqué de me surprendre. Ce n'est pas sa qualité qui m'a sauté aux yeux - je suis assez déçu par ma lecture de Meurtriers sans visage, la première enquête du célèbre policier Kurt Wallander : écriture fade (et même répétitive), intrigue sans relief, psychologie sommaire, et même quelque chose d'assez terne qui plombe un peu ce livre long, quoi que fluide...
(Rien à voir avec l'incroyable densité stylistique de James Ellroy ou d'Edward Bunker)
Non, ce qui m'a sauté aux yeux est le thème éminemment politique de ce roman : pour faire vite, un crime atroce est commis dans la campagne suédoise, et des étrangers sont mis en accusation, provoquant une vague impressionnante de xénophobie dans la région. Kurt Wallander va se rendre compte à quel point la politique d'immigration du pays n'est pas maîtrisée... La fréquence dans le roman de digressions (un brin simplistes, d'ailleurs) sur les dangers de laisser entrer n'importe qui dans le pays m'a naturellement laissé penser que l'auteur exprimait ici des opinions, disons... plutôt conservatrices.
Dans l'extrait suivant, c'est Kurt Wallander qui parle :
"C'est l'absence d'une véritable politique, sur ce point, qui est à l'origine de ce chaos. En ce moment, nous vivons dans un pays où n'importe qui peut pénétrer n'importe où, n'importe quand, de n'importe quelle façon et pour n'importe quelle raison. Il n'y a plus de contrôles aux frontières. La douane est paralysée. Il existe tout un tas de petits aérodromes non surveillés sur lesquels on débarque chaque nuit des immigrants en situation irrégulière ainsi que de la drogue." (Extrait de Meurtriers sans visage, Points, p 299)
Et pourtant j'ai lu quelques entretiens de l'auteur qui paraissaient contredire complètement la thèse exposée dans le roman (du moins, ce que j'en avais compris). Par exemple, dans une interview accordée au Nouvel Obs en janvier 2008 :
"Pour moi, le centre symbolique de l’Europe, c’est la petite île de Lampedusa, au sud de l’Italie. Car c’est là qu’échouent chaque jour les cadavres d’immigrants clandestins venus d’Afrique. Je trouve ça dégueulasse [en français dans le texte]. Et ce scandale nous oblige à nous demander: pouvons-nous accepter un tel monde? N’y a-t-il pas un autre moyen d’envisager l’immigration? J’ai un rêve simple: construire un pont entre le Maroc et l’Espagne. Nous savons bien que nous avons besoin de ces immigrants."
On dirait les propos de Kurt Wallander, en complètement inversés. L'auteur aurait-il viré sa cutie ? Cherche-t-il à exorciser dans ses romans la part conservatrice qu'il conserve en lui ? Présente-t-il au contraire un visage de parfait progressiste en interview pour faire pièce à ses atmosphères romanesques ? Prête-t-il à ses personnages des propos dont il se désolidarise complètement ?
A moins que les opinions exprimées par Wallander d'une part, et Mankell de l'autre, ne soient pas si contradictoires, dans la mesure où il est parfaitement possible, après tout, d'appeler à la fois de ses voeux des flux migratoires accrus, et des flux migratoires un tant soit peu "organisés"...
En tout état de cause je vais davantage me méfier, dorénavant, des couleurs politiques que je croirai déceler dans les romans. Ce devrait rester un principe, d'ailleurs, que de ne jamais chercher à savoir ce que pense le romancier, caché derrière les personnages qu'il met en lumière...