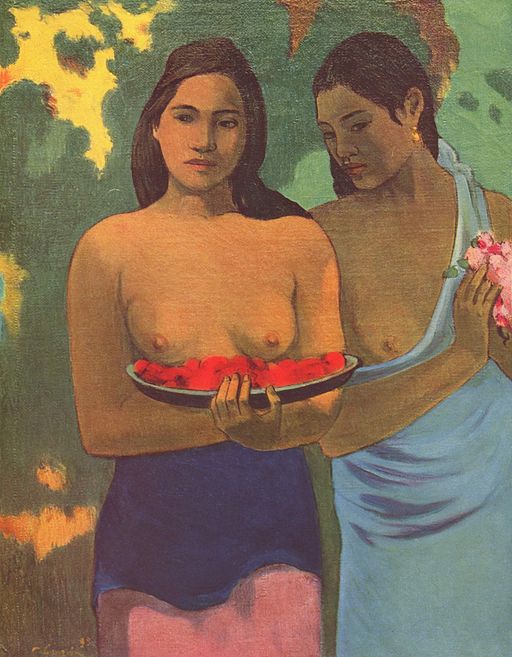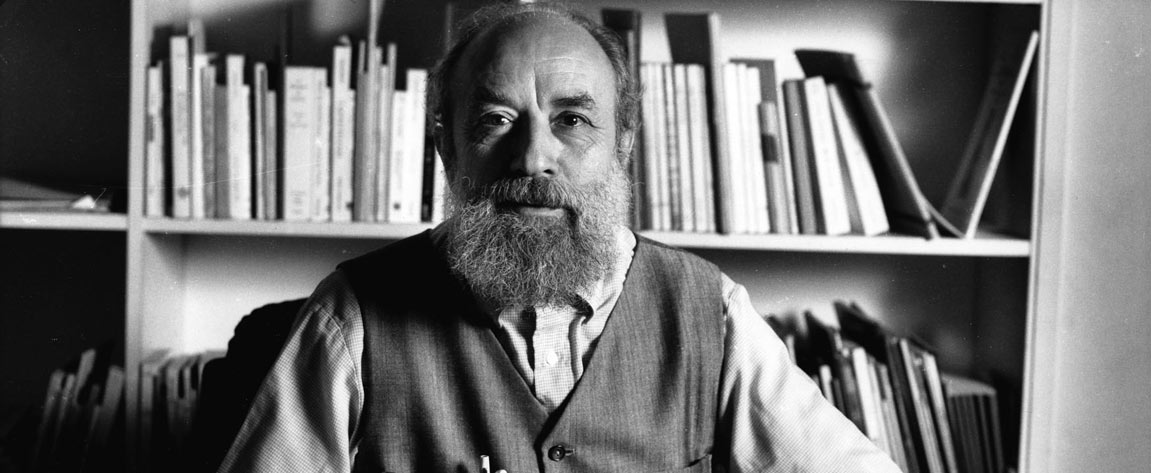"
Manifeste en faveur des classes moyennes", co-écrit avec Fabien Verdier, secrétaire nationale du Parti socialiste chargé du pôle "Production et répartition des richesses", sur le site du Huffington Post:
"Nous avons longtemps supposé que les classes moyennes étaient privilégiées et qu'elles devaient constituer la cible principale d'une politique fiscale exigeante. Or, force est de constater qu'elles sont en voie de paupérisation. Menacées par le déclassement, elles vivent de plus en plus mal la baisse de leur qualité de vie. A ce propos, nous entendons beaucoup cette phrase: "On paye toujours plus, mais on ne reçoit rien." Ce sentiment d'injustice fait des ravages dans un électorat pourtant enclin à voter à gauche. Le Parti socialiste, dont l'ambition a toujours été d'apporter son soutien à ceux qui souffrent, devrait tenir un discours fort en direction de ces classes-là.
Le problème est à la fois de nature économique (chômage, intérim, temps partiel subi, lourde imposition, perte de mobilité, crainte du déclassement...) et de nature identitaire, dimension dont la gauche a du mal à s'emparer: cela concerne autant les tensions liées au multiculturalisme que les mutations du monde rural ou encore les fortes difficultés liées au logement (coût des loyers, éloignement des pôles urbains...). Un tiers des Français sont "à l'euro près" en termes de dépenses lorsqu'ils vont faire leurs courses dans un supermarché!
Ainsi les classes moyennes commencent-elles à se sentir exclues des considérations politiques. A propos des questions culturelles, elles se déportent de plus en plus vers l'extrême droite (plus de 30% des inscrits) ou l'abstention (près des 40% des inscrits aux dernières élections régionales). A propos des questions économiques, elles éprouvent le sentiment de payer trop d'impôts et de ne pas bénéficier des aides publiques (municipales, départementales, régionales, nationales...).
Quant aux classes populaires censées être l'objet exclusif des attentions du Parti socialiste, elles ne se réduisent pas aux minorités ethniques comme beaucoup ont été tentés de le croire. Il est temps de considérer qu'il existe d'autres classes paupérisées -ouvriers, artisans, monde paysan- non exclusivement issues de l'immigration. Il ne s'agit certes pas d'opposer "petits Blancs" et enfants d'immigrés. Les deux groupes, aux frontières d'ailleurs floues, ayant chacun des raisons légitimes de protester. Mais plusieurs campagnes de communication ont laissé croire que les Blancs pauvres ne subissaient jamais de violences ni de discriminations. Mis en position d'accusés, ils se détournent naturellement d'un parti qui paraît les mépriser.
Par conséquent le Parti socialiste a tout intérêt, comme les démocrates américains ont par exemple eu l'intelligence de le faire avec Barack Obama (et son fameux discours de Philadelphie), de tenir compte de toutes les difficultés, de toutes les souffrances. C'est d'ailleurs le sens même du combat qu'il entend mener.
Quelques précisions sur les classes moyennes: il est possible de les définir comme les "50% des ménages dont le revenu brut disponible n'appartient ni aux 30 % les plus modestes, ni aux 20% les plus aisés" (Jörg Muller, CREDOC). En France, cela peut représenter jusqu'à environ 38 millions de personnes, recouvrant un ensemble de catégories professionnelles très variées, et surtout très nombreuses : enseignants, employés (plusieurs millions de personnes), personnel soignant, ouvriers, petits artisans, petits commerçants, chargés d'études, chargés d'affaires...
En politique, les ressentis comptent au moins autant que la réalité, si ce n'est davantage. Or, ces classes moyennes éprouvent durement le fait d'appartenir à une strate intermédiaire qu'elles perçoivent comme menacée. "Bientôt, il n'y aura plus que des riches et des pauvres" entend-on. Une intuition d'ailleurs validée par nombre d'études pointant la tendance profonde, dans les pays les plus développés, à une ventilation des classes moyennes vers le haut et vers le bas, sous l'effet d'une mondialisation souvent féroce. Ces deux phénomènes (difficulté à s'élever, menace du déclassement) nourrissent la défiance vis-à-vis des partis traditionnels, partis qui ont longtemps refusé de considérer les effets négatifs de la mondialisation.
Selon l'économiste Alain Lipietz, les classes moyennes ont commencé à se disloquer au milieu des années 1970. Une partie a accédé aux classes supérieures, mais la majorité s'est trouvée reclassée vers les couches populaires. Certains spécialistes (économistes, sociologues...) ont l'habitude de répondre, quand on les interroge à ce sujet: "Il est difficile de définir les classes moyennes puisqu'elles sont en voie de disparition..." Ce fatalisme explique une large part de la désaffection de ces classes moyennes. Et dit tout sur l'objet politique, économique et social, dont elles doivent faire l'objet.
Parfois difficiles à définir, elles constituent pourtant le creuset de notre société. Sans elles, point de démocratie. Sans elles, point de développement économique. Sans elles, point de redistribution. A l'écoute des classes moyennes, nous retrouverions l'élan qui nous fait défaut, la solidarité qui nous caractérise historiquement, l'idéal d'égalité que nous proposons depuis 1789, l'ambition de la fraternité dont nous avons tant besoin dans notre société moderne.
Nous pensons que le Parti socialiste a tout à gagner à redonner espoir à ces classes moyennes -qui constituent le pivot de toute démocratie- et à épauler les classes populaires pour qu'elles rejoignent ces rangs-là. Il convient de réfléchir à une politique fiscale moins négative à leur endroit; à une politique économique favorisant l'initiative; à une politique des mobilités (économique, sociale, culturelle...); à une politique des transports qui, couplée à celle du logement, améliore les vies quotidiennes (qui souffrent par exemple de trop longs trajets).
Retrouvons le sens du peuple! Car le cœur de la gauche, c'est le peuple. Et, par conséquent, d'abord et avant tout les classes moyennes."