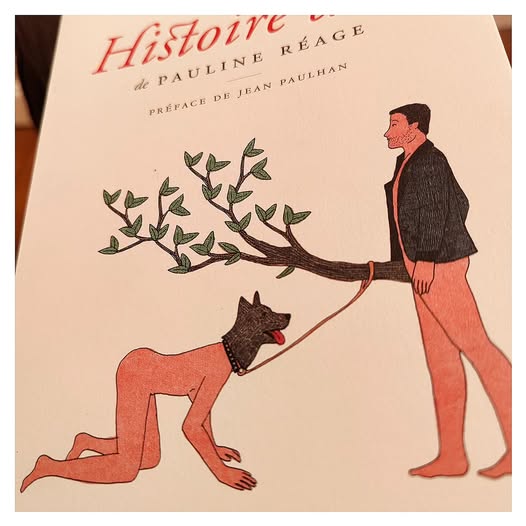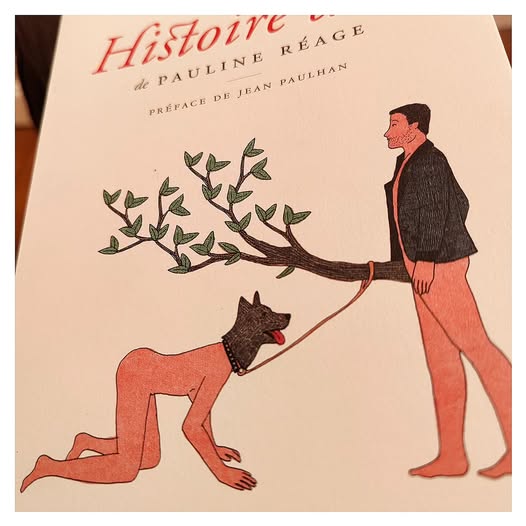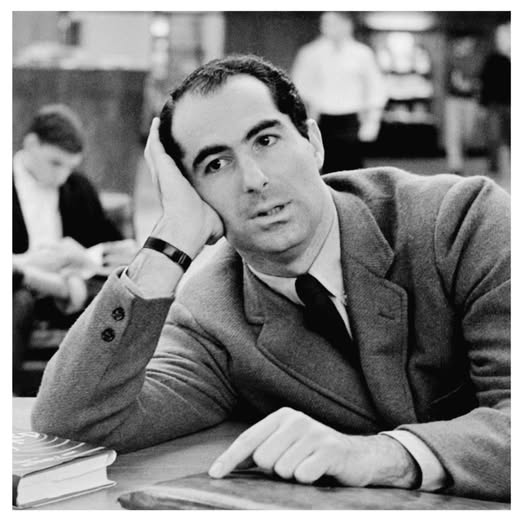Fabrice Pataut nous parle du roman "Spleen au Lavomatic" de Valère-Maris Marchand (Héliopodes, 2024) :
Malgré le spleen, nous sommes plus chez Balzac que chez Baudelaire dans ce roman très maîtrisé de Valère-Marie Marchand. Son premier, nous avertit la quatrième de couverture. C’est là une bien curieuse nouvelle. On a plutôt l’impression que l’auteur nous offre les prémices d’un ensemble beaucoup plus vaste encore immergé ou en gestation, le premier volet d’une comédie humaine du vingt-et-unième siècle dont le lavomatic est l’épicentre comme autrefois et pour d’autres siècles les salons des cocottes et les cafés des grands boulevards. On aurait tort de croire lire un roman habile et léger, la chronique mordante et sans complaisance d’un siècle pas même trentenaire qui tomberait dans le piège facile de l’anti-modernité.
Émilien (quel joli choix de prénom, suranné et presque descriptif) a égaré son manuscrit, un manuscrit au sens propre du terme, lequel contient des croquis, autrement dit un œuvre originale, authentiquement de la main du jeune homme, écrivain et dessinateur, auteur par ailleurs d’une œuvre poétique minuscule et improbable. Aucune nostalgie convenue dans ce portrait du vieux quartier Saint-Antoine fait de sandwicheries et de concepts-stores. Émilien Dorval, mou et indécis, petites lunettes et vêtements informes est là avec nous, je veux dire avec le siècle que nous partageons, mais comme on est assis de guingois sur le bras d’un fauteuil dans le salon où l’on reçoit pêle-mêle princesses et chiffoniers. Sans être vraiment présent, sinon pour mieux nous observer, prêt à nous quitter à la première saute d’humeur pour retrouver éternellement le même monde — bien sûr, quoi d’autre ? — quoique différemment éclairé. Par quoi ? Par la petite lumière du manuscrit perdu qui vascille, manque de s’éteindre mais ne fait jamais défaut. Tantôt lampe frontale, tantôt illumination soudaine de l’esprit, le manuscrit, souvent, se joue d’Émilien avec des airs de jeune effrontée.
Le manuscrit perdu, comme un doudou d’enfant ou le cadeau précieux d’un amour défunt, promet consolation et douleur. S’il était encore près de nous, sur la table de travail ou sous l’oreiller, il aurait tous les avantages tactiles et olfactifs de la chose qu’on regarde, touche et respire avec bonheur. Loin de nous, qui sait dans les mains d’un étranger qui ne pourra que lui vouloir du mal, il nous trahit, nous rappelle à quel point nous sommes différents et moindres sans ces objets qui nous sont consubstantiels. Mieux vaut encore le caniveau.
À propos de caniveaux (métaphoriquement parlant), Valère Marie-Marchand donne ci et là quelques petits coups de pattes bien sentis, griffes rentrées et sourire aux lèvres. Les imbéciles et les ferrailleurs, les indécis, les infatués comme les modestes passent un à un sous la loupe d’un Émilien à la fois furieux et contrit. Il les observe, les malheureux, à vrai dire plus malheureux que lui encore, et le fait d’en haut sans complaisance, à la manière d’un homme triste allant le long d’un trottoir côté chaussée des fois que son manuscrit pourrait passer par là avec mégots, capsules et mouchoirs malmenés par le courant.
Mais revenons au Lavomatic où le jeune Dorval mène l’enquête in situ. Il y a là, bien sûr, un leurre, pour ne pas dire un oxymore. Plus qu’un lieu fixe où le détective s’attend à un retour du criminel sur le lieu du crime, c’est une boîte dans la boîte dans la boîte qui s’ouvre à l’infini, proposant chemin faisant des pistes possibles, des croisements, des bifurcations. Narcisse apparaît derrière le hublot de la machine à laver le linge n° 6, laquelle est au lavomatic, lequel est à Paris 11ème, lequel Paris est celui de l’Aurélien d’Aragon qui souffle à Émilien le merveilleux incipit La première fois qu’Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide, lequel incipit s’applique plutôt mal à Fleur de bitume, parigote qui entre inopinément dans ledit Lavomatic où ladite machine n° 6 fait des siennes. Narcisse, aperçu derrière le hublot de la 6, n’est rien de moins que le fils d’un dieu et d’une nymphe. Fleur de bitume, qu’on le veuille ou non, franchement laide ou pas, a du charme, un charme d’un genre qui rappelle celui du Garance de l’immense Arletty.
En quoi ce premier roman nous donne à la fois beaucoup de liberté et exige de nous une lecture attentive. Chacun choisira un ou plusieurs auteurs préférés parmi ceux ici convoqués par Valère-Marie Marchand, pour suivre une piste plutôt qu’une autre mais sans jamais quitter le jeune Dorval, lequel devient, au fur et à mesure que nous avançons, un compagnon de voyage. Là où un auteur moindre serait tombé dans le piège de l’érudition fastidieuse, Marchand se joue des codes, sobrement, avec légéreté, goût et drôlerie.
Il est beaucoup question de synesthésie dans ce livre où l’on peut aussi bien déguster les couleurs que renifler l’odeur des reflets en compagnie d’Émilien, victime consentante des troubles systématiques de la perception. La synesthésie la plus remarquable de notre lavomaticien émérite reste néanmoins d’un genre déviant. Car il y a bien comme un trouble de la perception dans la manière dont Émilien finit par retrouver son cher manuscrit. Je ne dévoilerai pas la clef de l’énigme, à la fois drôle, bête comme chou et troublante, qui implique un quidam volontairement sous séquestre et un miroir sans tain digne des meilleures maisons de passe. C’est par une sorte d’aperception déviante, de perception qui s’aperçoit elle-même en train de prendre un chemin de traverse qu’Émilien se retrouve, plus diffracté que jamais avec au centre un noyau dur, l’essence même du synesthésien émérite, le Dorval en soi d’un Paris poétique, coquin et jeteur de sorts.
Il faut lire Spleen au lavomatic de Valère-Marie Marchand comme on le lirait si Émilien Dorval l’avait commencé puis bêtement perdu dans le quartier Saint-Antoine, comme l’épopée urbaine des petits riens patiemment recouvrés par l’auteur auxquels la littérature rend si généreusement leur dignité perdue."