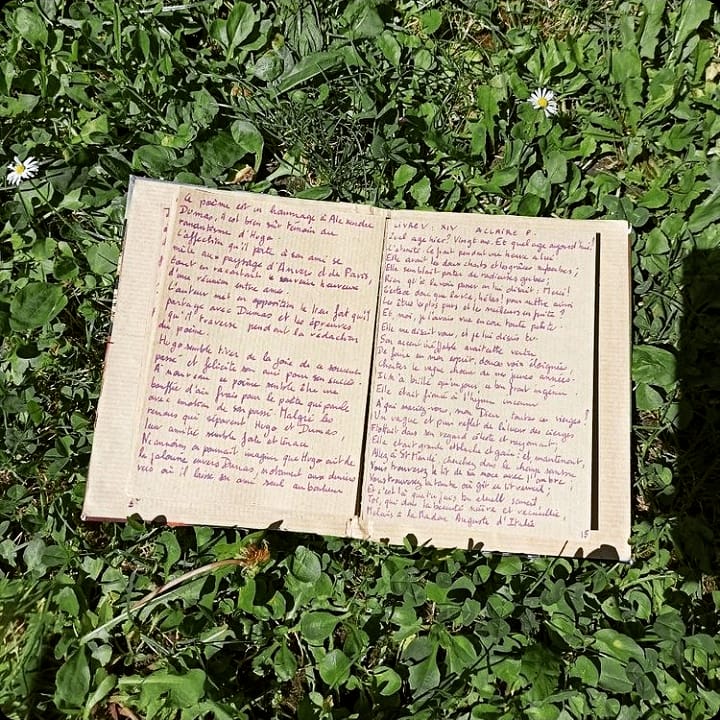C’est devenu un genre en soi, les livres sur les attentats – un genre nouveau. On en attend quelques passages obligés : la description des faits, le récit de la guérison, l’évocation du trauma, une réflexion politique, pourquoi pas philosophique, et, dans le cas d’auteurs étiquetés comme écrivains, une mise en abyme du travail d’écriture.
La plupart des rescapés de Charlie Hebdo étaient des artistes, on a donc eu droit à une flopée d’ouvrages éminemment littéraires. Dans le cas du Bataclan, seul le livre d’Erwan Larher à ma connaissance est celui d’un auteur en tant que tel – « Le livre que je ne voulais pas écrire », (Quidam Editeur, 2016). C’est pour cela que je l’ai lu en premier, d’autant que j’avais pu croiser Erwan ici ou là et que son titre était bon.
Quelle est la part de voyeurisme qui nous décide à ce genre de lecture ? Importante, bien sûr. Mais elle n’est pas la seule. Pour ma part, je guette vraiment les analyses politiques, ainsi que le regard porté sur la violence. J’ai toujours trouvé que les Américains se coltinaient facilement avec ce thème-là, en littérature comme au cinéma. La France s’est toujours montrée plus réticente, du moins depuis la IIème Guerre mondiale. D’une certaine manière, les attentats lui braquent la conscience vers de genre de phénomènes, et à cet égard la belle couverture de livre de Riss, « Une minute quarante-neuf secondes », est symptomatique – nous y reviendrons.
Le témoignage de Larher tient ses promesses quand il s’agit des faits. Dans un style énergique et vivant – un peu trop relâché à mon goût 😊 – il décrit avec une belle sincérité les moments de terreur, de souffrance et de honte qui ont émaillé les événements, de même qu’il évoque avec une émotion communicative la phase de reconstruction mentale et physique, y compris les problèmes d’érection.
A vrai dire, ce sont les analyses politiques que je redoutais. J’avais peur de développements simplistes ou agaçants – pire, j’avais peur d’un refus d’analyser. Or, l’auteur se prête à l’exercice avec générosité. A plusieurs reprises il se lance dans des tentatives de compréhension qui virent certes au catalogue d’hypothèses et au déversoir de réflexions diverses – et contradictoires – sur l’époque, mais la profusion neutralise la simplicité de chaque argument. En fin de compte, ce sont des monologues intérieurs qui rendent bien compte des tempêtes morales. De toute façon, peut-on raisonnablement attendre d’un récit la même densité d’analyse que dans un essai de philosophie politique ?
A la fin du livre, le propos se précise. Larher parvient à ramasser sa pensée en quelques convictions bien senties – d’ailleurs, le style se densifie à ce moment-là. Au fond, l’auteur se dit rousseauiste, la méchanceté des hommes lui paraît provoquée par le malheur en société, il ne faut pas en vouloir aux agresseurs, il faut les plaindre et surtout œuvrer à éteindre les passions communautaires qui gangrènent le pays. On l’aura compris, le message ultime rejoint le fameux « Vous n’aurez pas ma haine » d’un autre livre (dont je parlerai aussi bientôt).
« «
Tu leur en veux, aux terroristes » te demande ta cousine de vingt ans. Non. Tu en veux à Julia, qui t’a trahi autrefois ; tu en veux à François Hollande, qui a menti à ses électeurs ; tu en veux à la société, à l’organisation du monde, à l’oppression économique, à la misère intellectuelle – mais pas plus qu’avant. Tu n’en veux à personne pour cette balle dévirilisante. Tu ne sais pas qui sont tes assaillants. Tu ne connais pas leurs noms. Ils n’existent pas. Parce que si ça n’avait pas été eux, ç’aurait été d’autres. » (Page 225)
Précisons que je n’ai pas vécu les événements, et que je ne me sens donc pas le droit de juger le comportement des victimes. Mais je reste gêné que la colère ne s’exprime pas davantage. Je comprends qu’on veuille la surmonter, voire la combattre. Sans doute a-t-elle aussi quelque chose de honteux. Mais faire comme si elle n’existait pas me paraît relever à la fois du symptôme et de l’idéalisme un peu fou.
Malgré tout, le livre ménage tellement de passages sur les peurs, les doutes et les angoisses qu’il est difficile de reprocher à l’auteur son manque de sincérité. Disons que le livre fait le travail, que l’auteur mouille la chemise et que là est l’essentiel.
Le seul moment où perce une colère franche et limpide survient dans une page écrite par un ami anonyme :
«
Après l’effroi et l’angoisse, c’est maintenant la colère qui me domine. Colère contre ces barbares – qu’est-ce qu’ils croient ? –, colère contre ma patrie incapable de protéger sa jeunesse – alors voilà, on peut débarquer à Paris avec des kalachnikovs et ouvrir le feu au hasard, ou pas forcément au hasard mais sur n’importe qui – et Dieu est dans n’importe qui –, colère contre Erwan qui sort sans téléphone portable – comme si ça pouvait changer quelque chose à ce moment-là – et colère à nouveau contre Erwan parce que je suis certain que, quand il va sortir de cet enfer, il ne va même pas leur en vouloir, il va continuer à regarder le monde avec sa tête de cyber ludion au charme en bandoulière – et c’est tant mieux. » (Page 61)
Ce passage pourtant simple me paraît essentiel – une sorte de préalable.
De manière ironique, c’est ainsi dans un texte annexe que sont posées quelques-unes des intuitions fondatrices. Et le dispositif littéraire – le livre alterne chapitres écrits par l’auteur et chapitres écrits par d’autres – prend alors son sens. Il valide le fait que nous avons bien affaire à un exercice littéraire et il permet, en variant les points de vue, d’offrir quelque chose comme un panel de tous les genres d’émotions provoquées par ce genre d’événement, au-delà des pudeurs, des principes et des crispations qui tiennent chacun de nous.