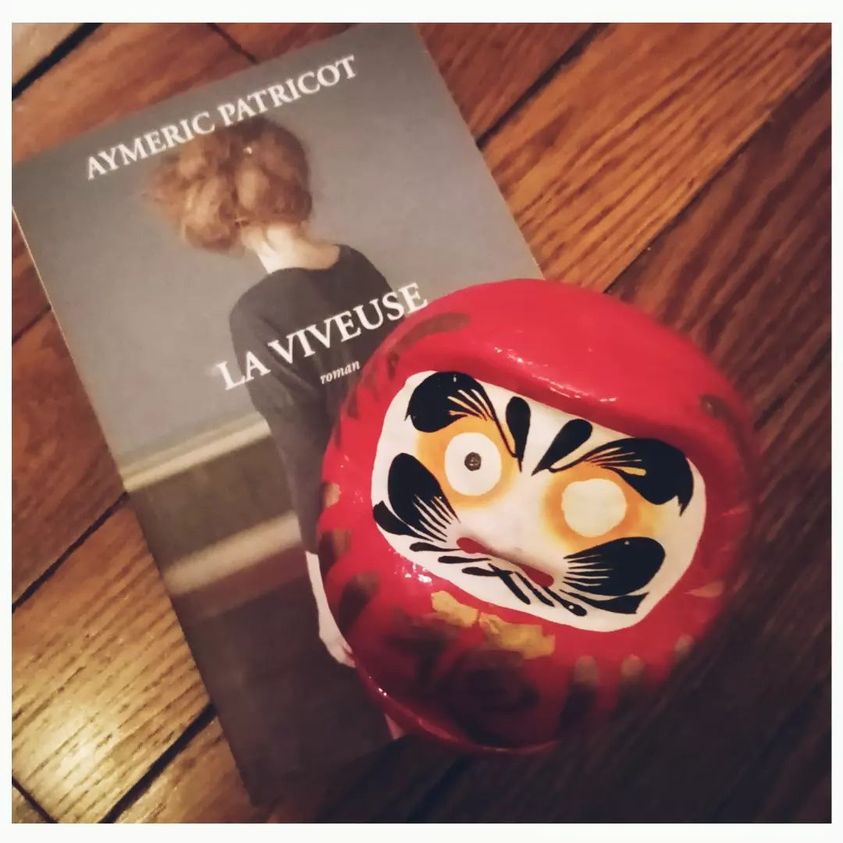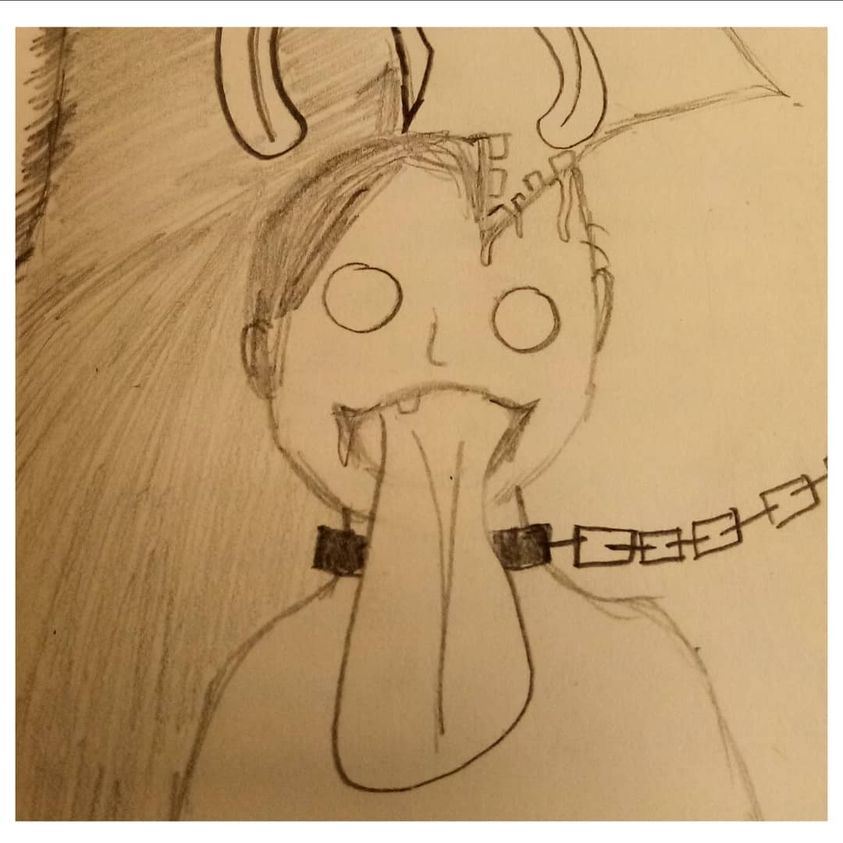dimanche 6 février 2022
"Lamour au temps du handicap" (Raphaëlle Dos Santos, à propos de "La Viveuse")
Par admin, dimanche 6 février 2022 à 18:28 :: La Viveuse (2022)
"La Japan expo est un forum sur la culture populaire japonaise. On y croise des amateurs de Pikachu et de Lara Croft. C’est dans ce décor ambigu de dessins animés et de filles en mini-jupes, qu’une aide-soignante, Anaëlle, fait la connaissance de Christian, un handicapé. Jusqu’ici, trois hommes occupaient la vie d’Anaëlle : Philippe, avec qui elle hésite à s’installer (parce qu’il est trop « tendre », et finalement trop enfantin) ; Frank, un amant occasionnel (mais qui se révèlera instable) ; et son père, rendu amer par son récent divorce. La rencontre avec Christian va réorienter sa vie. Il l’attire – et très vite va se poser la double question des raisons de cette attirance, et de la sexualité. Elle se découvre animée par des désirs qui, si éloignés qu’ils semblent, se marient parfaitement : la bienveillance, la volonté d’« apporter du réconfort » ; et le plaisir de la mainmise sur son partenaire : Anaëlle aime que Christian soit physiquement à sa merci.
LA SEXUALITÉ ASSISTÉE
Guidée par Mathieu, un ami infirmier, elle découvre une association spécialisée dans « l’assistanat sexuel », tarifé ou bénévole. Elle participe à des réunions pour se former à cette « activité », qui pourrait devenir un métier : elle a besoin d’argent pour son père. Elle a bien sûr conscience de la difficulté que l’on aura à la distinguer d’une prostituée. Pourtant, ceux qu’elle rencontre dans l’association ne semblent pas poussés par des intérêts financiers – bien que leurs motivations ne soient pas toujours sans équivoque : « Je n’ai jamais été en couple et je n’ai plus de rapport avec ma famille, explique une jeune femme. Je considère les handicapés comme des frères de destin. Ce que je leur donne, c’est un peu comme si je me l’offrais à moi-même. »
Anaëlle est également ambivalente. Elle aime le « sentiment de puissance » que lui procure le corps des infirmes livrés à ses caresses. « Au fond, reconnaît-elle, la personnalité de [Christian] l’intéressait moins que son handicap ». Mais ses intentions changent selon les « patients » : « Elle glissa la paume sous la nuque afin d’inciter le jeune homme à se redresser, ôta la chemise qu’elle déposa comme une relique sur le dossier de la chaise. » Le mot et les gestes sont autant chrétiens et sacrificiels que médicaux. D’ailleurs, en sortant de la chambre de Martin, un myopathe, elle éprouve d’abord de la honte, une poussière morale qu’elle chasse d’un souffle : « Pourquoi se sentir coupable ? Elle avait travaillé au bien-être d’un individu diminué, et elle parvint à éteindre ses scrupules. L’épaisseur des billets faisaient une présence rassurante. »
SAINTE, PERVERSE OU PROSTITUÉE
Anaëlle est donc traversée par trois rôles, « celui d’une sainte, d’une perverse ou d’une prostituée », passant de l’un à l’autre en passant d’un patient à l’autre, de Christian à Martin, de Martin à Didier. En somme, La Viveuse est le roman d’une évolution psychologique à travers la sexualité. Partie de Philippe (grand enfant à la sexualité simple et sans surprise) et de Frank (à la sexualité excitante et animale), elle réconcilie avec Christian ses besoins de réconfort, de soin et de puissance, dans leur rapport ambigu à l’excitation sexuelle. Portée par un mélange d’altruisme et de narcissisme, de don de soi et de suprématie, elle sait que l’on n’échappe pas à la dépendance : on dépend tous de quelqu’un – le père d’Anaëlle dépend de l’argent de sa fille, les patients dépendent de la sensualité d’Anaëlle, et celle-ci dépend de l’argent qu’on lui verse.
RAPPORTS DE CLASSE
Une dépendance est un rapport de pouvoir, et tout pouvoir un rapport sexuel direct ou différé ; il était donc naturel que ce roman traitât des classes sociales, et des rapports de classe. À cet égard, il s’inscrit dans la lignée de deux autres livres, au moins, d’Aymeric Patricot : Les Petits Blancs et La révolte des Gaulois.
La Viveuse est le roman d’une prolétaire. Anaëlle a conscience d’avoir seulement « son corps à offrir » ; sa meilleure amie, Pauline, et certains de ses patients, sont d’un milieu aisé : ils ont les moyens financiers de s’offrir Anaëlle. Quand Pauline obtient un appartement pour le père de son amie, ce geste solidifie leur amitié et creuse ce qui les sépare – et qui est, encore une fois, la dépendance : Anaëlle n’aime pas se sentir redevable. Il en va différemment avec Christian, à qui elle refuse de « tarifer ses prestations ».
Une scène entre la mère du jeune infirme et Anaëlle montre d’ailleurs, dans la domination qui essaie de s’installer, un vrai rapport de classes : « Je ne fais pas ça pour l’argent », dit Anaëlle en refusant la somme que cette mère lui propose. « Ah bon, pour quoi alors ? ― Je ne sais pas… Pour l’amitié, peut-être. ― À d’autres ! » Cette femme aimerait mieux que son fils ait affaire à une prostituée : l’argent la rassurerait sur les intentions de cette « assistante sexuelle », qui, ramenée à la vénalité, en ressortirait en outre diminuée. En refusant d’être payée, Anaëlle échappe à cette mère, elle échappe à la domination, elle échappe à la société.
Ce roman riche et singulier passionne parce qu’il croise adroitement les questions morales, sociales, professionnelles, autour du sexe et du soin, de l’argent et de l’amour ; et parce qu’il devient une réflexion sur le pouvoir et la soumission, à condition de retirer à ces deux notions leur préjugé négatif – et c’est tout le talent d’Aymeric Patricot d’y parvenir, sans moralisation ni complaisance. Avec un essai, il aurait peut-être essayé de trancher la question ; en choisissant le roman, ce genre de l’ambiguïté, du croisement des contraires, il pousse le lecteur vers des régions qu’il n’aurait pas pensé visiter."