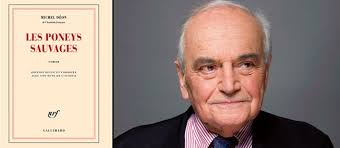Je me suis toujours dit qu’il existait un point aveugle dans l’œuvre d’Albert Camus, une œuvre que je trouve par ailleurs magnifique : ce qu’on pourrait appeler la tension raciale dans l’Algérie coloniale. Une tension raciale que Camus décrit parfois mais sans qu’elle paraisse ne le concerner vraiment, ou alors de manière inconsciente. C’est évidemment spectaculaire dans L’Etranger. Le crime central dans ce roman y est souvent décrit comme provoqué par le sentiment d’absurde – le narrateur lui-même se complait dans cette explication-là – mais personne ne semble remarquer, l’auteur en premier, que le crime pourrait être justifié par quelque chose de beaucoup moins avouable, à savoir la haine que pouvait éprouver le Français d’Algérie pour ces Arabes anonymes qu’il percevait, partout dans l’espace public, comme menaçants.
« Le premier homme » évoquera, plus tard, de manière plus explicite, cette tension-là, mais sans s’y attarder. Et la fameuse chanson de Cure inspirée par le roman, « Killing an Arab », aura toujours suscité le malaise en révélant, de manière assez maladroite, le sens caché qu’il est permis de voir assez spontanément dans l’intrigue de Camus.
Quoi qu’il en soit, je me suis toujours étonné qu’on ne s’interroge pas davantage sur cette dimension de l’œuvre et je n’ai donc pas été surpris qu’un romancier,
Kamel Daoud, prête la parole précisément au personnage tué par Meursault, cet Arabe sans nom, vite tué, vite enterré, oublié derrière les considérations métaphysico-poétiques du narrateur. Pour être plus précis, c’est au frère de ce personnage qu’il donne vie, un frère dont le seul but sera de rendre à la victime anonyme sa dignité. Je n’ai pas été surpris non plus par le succès de ce «
Meursault, contre-enquête » (Actes Sud, 2014), un peu comme s’il venait combler un manque que tout le monde avait à l’esprit sans trop oser le dire.
L’exercice littéraire est réussi, court mais intense, marqué par une singulière mélancolie. Les colons en prennent pour leur grade mais aussi l’Algérie contemporaine, dont l’auteur souligne les beautés comme les manquements – surtout les manquements, d’ailleurs. Au point que l’on retrouve paradoxalement un même sentiment d’absurde, même s’il ne se pare plus des beaux atours de la philosophie.
Dans l’une des pages les plus belles, et pas la moins audacieuse, le narrateur – frère, donc, de l’Arabe tué par Meursault – décrit par exemple en termes caustiques les vendredis de prière :
« Nous sommes vendredi. C’est la journée la plus proche de la mort dans mon calendrier. Les gens se travestissent, cèdent au ridicule de l’accoutrement, déambulent dans les rues encore en pyjama ou presque alors qu’il est midi, traînent en pantoufles comme s’ils étaient dispensés, ce jour-là, des exigences de la civilité. La foi, chez nous, flatte d’intimes paresses, autorise un spectaculaire laisser-aller chaque vendredi, comme si les hommes allaient vers Dieu tout chiffonnés, tout négligés. As-tu constaté comme les gens s’habillent de plus en plus mal ? » (Edition Babel, page 78)