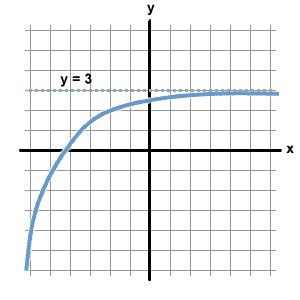vendredi 14 novembre 2008
Les écrivains sont des gens bien / On n'est pas là pour caresser les chats !
Par admin, vendredi 14 novembre 2008 à 22:02 :: Billets d'humeur (relative)
(Clip de la semaine : sublime chanson que ce I love you golden blue, titre crépusculaire pour le groupe Sonic Youth, qui signait avec cet avant-dernier album, Sonic Nurse, son album le plus mélodique et le plus délicieusement mélancolique... Le son Sonic Youth, on le retrouve quasiment à l'identique sur chaque album, mais il est tellement efficace...)
Hier matin, conversation échevelée près de la photocopieuse : une collègue de mon lycée de la Courneuve, par ailleurs poétesse émérite (je connaissais son nom, j'avais d'ailleurs plusieurs volumes d'elle dans le rayon que je consacre à la poésie), publiée chez P.O.L, m'a remonté le moral après le coup dur qui m'était arrivé la veille. Extrait :
- Je m'en sors pas ! Depuis deux ans, tout ce que j'entreprends est un échec ! Hier, ce renvoi d'un boulot qui me tenait à coeur, comme un malpropre... Et puis tous ces manuscrits qu'on me refuse, encore et toujours, mois après mois... Et puis mon couple, qui s'est pété la gueule, et puis... Comment tu fais, toi, pour tenir le coup ? Franchement, cette manie d'écrire, j'ai l'impression qu'elle me bouffe la vie, et qu'il n'en reste pas grand chose... C'est dingue les sacrifices que ça implique !
- C'est sûr ! Moi je tiens parce qu'on est tout un petit groupe de poètes, chez P.O.L., une dizaine, et qu'on se sert les coudes à toute occasion ! Notre éditeur nous apporte un soutien considérable ! Il m'a souvent dit : "Je prendrai tout ce que vous m'apportez, ma chère ! Je veux tout de vous !"
- Tu as de la chance... Je suppose que tu ne gagnes pas grand chose ?
- Tu penses bien ! Rien du tout ! Mais ça me permet de voyager, malgré tout... C'est un grand bonheur, ça, les voyages pour faire des conférences ! A tel point que je n'imagine presque plus voyager si ce n'est pas dans ce cadre...
- J'imagine ! J'ai un autre problème, tu sais : le dernier manuscrit que j'ai écrit, c'est encore quelque chose de très sombre... J'ai peur d'être catalogué ! Il y a pas mal de lecteurs qui trouvent ce que j'écris trop pessimiste...
- Tu les emmerdes ! C'est pas eux qui vont te dicter ce que tu dois faire ! Même un éditeur, il ne doit pas s'immiscer dans ton travail ! Ca doit venir de toi ! Tu suis ton chemin, sans te préoccuper de ce qu'on te dit ! Jamais écouter les autres, c'est la base ! Ils ne comprennent rien ! C'est incroyable, ça, de dire à quelqu'un que ce qu'il fait est trop pessimiste... Merde, on est en littérature ! On n'est pas là... comment dire... On n'est pas là pour caresser les chats !
- Ah ah ! Tu as raison !
- Moi je fonctionne de la façon suivante : toujours présenter un travail nickel... Quitte à patienter six mois, un an, avant de présenter un livre. Je ne fais jamais lire à personne avant de donner le manuscrit à l'éditeur ! Mais quand je le donne, je sais qu'il n'y a rien à retoucher ! Et jamais mon éditeur ne m'a demandé la moindre correction !
- Tu as sans doute raison... J'ai le défaut d'être impatient... Il faut que je souffle un peu, que je ralentisse le rythme...
- Et surtout, je le répète, ne jamais faire lire quand le travail n'est pas achevé... C'est le meilleur moyen pour que le lecteur s'engouffre dans le livre, tu vois, un peu comme pour se l'approprier, et foutre tout ton travail en l'air... On ne sait plus où l'on en est, après, on ne sait plus pour qui on travaille ! Pour le lecteur ? Pour soi ?
- Bon, ça me requinque, cette conversation... Je vais arrêter de vouloir caresser les chats, en tout cas...