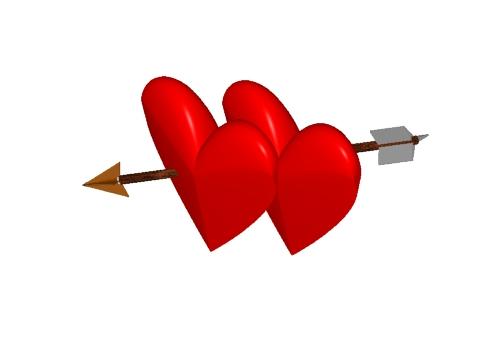1)
1) Aujourd'hui une histoire d'amour
Demain peut-être plus rien
Toi et moi pour toujours
Seulement si la vie nous en donne les moyens
Comment aimer sans pouvoir autant te détester
Avec ton visage qui envahit toutes mes pensées
Chaque jour je pense à toi,
Toute seule dans mon coin
Avec cet espoir
De pouvoir vivre enfin,
Une merveilleuse histoire.
Pour toi mon coeur,
Je voudrais savoir voler pour pouvoir le décrocher
Durant toutes ces heures,
Sans jamais cesser de t'aimer.
Un jour sans toi, je n'ose m'imaginer
Mais plutôt contre toi, meilleure sera cette idée.
Un et un font deux,
Toi et moi font nous,
Mais tu ne peux
Qu'être mon tout
Car je le veux.
Caroline Sedira, 2DM (Seconde Dessinateurs Maquetistes)
2) PARIS
Commencez par le métro,
Puis passer par le Louvre,
C'est toutes les portes que Paris vous ouvre.
Mais malgré la pollution,
Vous y découvrirez
Toute une multitude de musées.
N'ayez peur de sa banlieue,
Bien qu'elle soit un peu craintive,
Elle reste tout de même très créative.
Incrustez-vous dans le monde,
Visitez donc les boutiques,
C'est une histoire très sympathique
Ce sont bien les touristes,
Qui viennent voir la capitale,
Cela n'est rien d'une ville banale.
Félix, 2DM
3) Amour cachéLorsque je t'ai vue la première fois,
Ton image est restée gravée en moi.
Je ne pourrai jamais m'en détacher
Et personne ne pourra me l'arracher.
Ta chevelure, douce comme la soie
Me rend complètement dingue de toi.
Et de par tes yeux, les plus merveilleux
Je sais maintenant, je suis amoureux.
Mais saurais-je maintenant t'en parler ?
Ne risquerai-je pas de regretter ?
Car je ne voudrais pas te voir partir
Je ne supporterais pas d'en souffrir.
Pourtant pas besoin de milliers de mots
Pour moi ces deux seuls mots sont les plus beaux
Pour te révéler tous mes sentiments
Et tu les mérites très amplement.
Je t'aime et rien ne pourra le changer
Je ne veux que rester à tes côtés
Que ce soit dans les pleurs ou le malheur
Et te donner à jamais tout mon coeur.
Sébastien Lahaye, 2DM