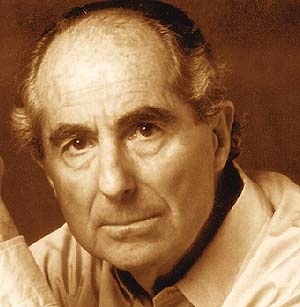lundi 30 avril 2012
Comment réduire sa vie en chiffres ?
Par admin, lundi 30 avril 2012 à 19:36 :: Littérature française

Jolie conférence, mardi dernier, sur le thème des Journaux d’écrivains (organisée par la joyeuse équipe des « rendez-vous littéraires », Ariane Charton et Lauren Malka) : Michel Braud, notamment, y a évoqué le journal de Benjamin Constant, un journal que j’aime beaucoup par le contraste entre ses premières pages, amples et romantiques (quoi que très cruelles avec les femmes) et les dernières, se réduisant à des séries de chiffres : Constant avait dressé la liste d’une petite vingtaine de choses revenant constamment dans sa vie (le travail, l’envie de renouer ou de rompre avec telle personne, les soucis de tel ordre…) et il se contentait, lassé par les confidences littéraires, de noter chaque jour les chiffres correspondant à ce qu’il faisait.
Ce système m’a toujours fait rire. J’aime beaucoup ce mélange de désinvolture et de cynisme (légèrement désespéré).
Il faut dire que je ne suis pas loin d’être aussi fou – je vais même plus loin que Constant dans la folie maniaque et l’amour des statistiques : depuis deux ou trois ans maintenant, j’ai pris l’habitude de noter rapidement ce que je fais chaque jour, tout en précisant le nombre de pages écrites. Je fais un bilan chaque semaine, chaque mois, chaque année, poussant la perversité chiffrée jusqu’à mettre une note (de une à cinq étoiles) mesurant chaque mois mon degré de bonheur. Puis j’établis une moyenne mensuelle par année – ainsi qu’une moyenne du nombre de pages écrites.
Réfléchissant au sens de cette démarche, je pense qu’elle me permet à la fois d’apaiser le sentiment d’une vie qui s’écoule sans qu’on en retienne rien, et de m’obliger d’une certaine manière à être heureux. Cette décision de parvenir à toujours plus de sérénité s’est faite en moi il y a quelques années maintenant. Cela peut paraître mesquin, dérisoire, pathologique, cela ne m’aide pas moins à peaufiner comme un petit art du bonheur quotidien – ce qui n’a rien de superflu quand on s’est intéressé bien trop tard, comme moi, au simple fait de bien vivre.