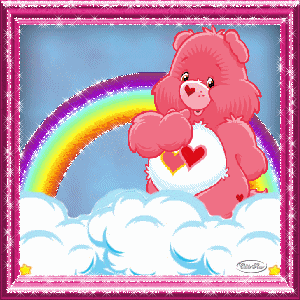dimanche 14 septembre 2008
Derrière la caméra, Houellebecq = Rohmer + Tarkovski (La Possibilité d'une Ile)
Par admin, dimanche 14 septembre 2008 à 21:39 :: Littérature française
Dans le dossier de presse de La Possibilité d'une Ile, tout juste sorti sur les écrans, Houellebecq écrivait qu'il était "sincèrement haï par quasiment tout ce qui est culturel en France." Dans une interview parue dans le Tecknikart de Septembre 2008, il déclare : "Je ne sais pas pourquoi les gens choisissent de me haïr mais là, j'ai quatre expériences consécutives qui le prouvent : on n'a pas eu, avec Philippe Harel, l'avance sur recettes pour Extension du Domaine de la Lutte. Ensuite il l'a ratée deux fois de suite pour les Particules Elémentaires, qu'on a dû abandonner - c'est un Allemand qui l'a fait. Et je l'ai ratée pour la Possibilité. Et tous les projets de théâtre à partir de mes livres soumis à une commission ont été refusés en France".
En tout cas le résultat de l'adaptation sur écran du génial roman la Possibilité d'une Ile a de quoi surprendre. On retrouve le même fil narratif mais réduit à sa plus simple expression, dépouillé des deux tiers de ce qui faisait le charme du roman : le protagoniste n'est plus cet humoriste bordeline qui donnait toute sa dimension sulfurique au livre ; disparues également toutes références au sexe (ou de manière très allusive); il ne reste guère que les considérations sur les Néo-Humains, ces nouvelles générations d'hommes qui se reproduisent par un savant système de clonage et survivent à toutes les catastrophes frappant le reste de l'Humanité.
Cela nous donne un film quasiment muet : très peu de dialogues, quelques vagues monologues à peine audibles, alors que le génie de Houellebeq réside me semble-t-il dans ses longues digressions pleines de considérations désabusées, faussement détachées. L'atmosphère tour à tout apocalyptique et crépusculaire, sur fond de silence ou de musique grandiloquente, pourrait évoquer Tarkovski, tandis que la mise en scène minimaliste, décalée, sous-jouée, lorgnerait plutôt vers Rohmer.
Que penser du mélange ? A vrai dire je ne sais pas trop. L'ensemble est peu convaincant, c'est le moins qu'on puisse dire. En même temps l'uanimité contre ce film me gêne un peu, dans la mesure où j'ai déjà vu des navets tout aussi phénoménaux s'attirer des louanges à n'en plus finir. Houellebecq aurait-il raison de se croire haï par une bonne partie des milieux culturels ?
Repassons-nous pour le plaisir, en attendant son prochain roman, ce moment d'anthologie qu'est son interview par Ardisson (chaque fois que je réentends les toutes premières répliques de cette vidéo, j'ai envie de les apprendre par coeur) :
J'ai d'autre part découvert cet été la réédition en poche de son tout petit essai sur H.P. Lovecraft, Contre le Monde, Contre la Vie : très simple présentation de l'oeuvre de cet auteur de romans d'épouvante, mais ponctuée d'un humour pince-sans-rire et d'une noirceur délicieuse comme on n'en trouve sans doute chez personne d'autre, aujourd'hui, en littérature française (ou je ne les connais pas).
Exemple, avec la page d'ouverture : "La vie est douloureuse et décevante. Inutile, par conséquent, d'écrire de nouveaux romans réalistes. Sur la réalité en général, nous savons déjà à quoi nous en tenir ; et nous n'avons guère envie d'en apprendre davantage. L'humanité telle qu'elle est ne nous inspire plus qu'une curiosité mitigée. Toutes ces "notations" d'une si prodigieuse finesse, ces "situations", ces anecdotes... Tout cela ne fait, le livre une fois refermé, que nous confirmer dans une légère sensation d'écoeurement déjà suffisamment alimentée par n'importe quelle journée de "vie réelle."" (p13)