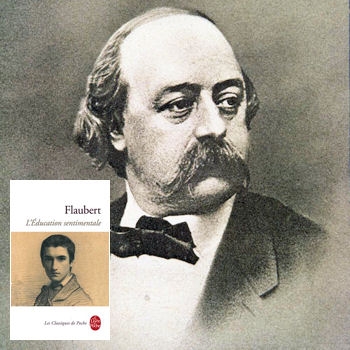jeudi 29 septembre 2011
Le réalisme hypertendu de Roth et Weitzmann
Par admin, jeudi 29 septembre 2011 à 20:27 :: Littérature française
Marc Weitzmann par Mediapart
Il est assez courant de considérer Marc Weitzmann comme un digne représentant du style de Philip Roth en France. Il est vrai que les deux œuvres ont en commun l’interrogation sur l’identité juive, bien sûr, mais surtout un ton, un genre, qu’on pourrait définir comme une sorte de réalisme hypertendu : débarrassées de toute préciosité, de tout marqueur stylistique, les intrigues se déploient avec une redoutable fluidité, comme pressées par un sentiment de crise, les personnages constamment suspendus sur leurs gouffres existentiels, souvent incapables de comprendre leur existence et débordés par des forces insondables.
Ils partent pour des quêtes, cherchent à résoudre des mystères, tout cela dans une atmosphère de tragédie perpétuelle – l’humour et le délire érotique permettant parfois de survivre.
De Weitzmann, j’ai dévoré à sa sortie Fraternité (Denoël, 2006), dont le souffle noir m’avait envoûté (le tableau de la déliquescence des banlieues françaises est effrayant). Mariage mixte (Stock, 2000), je n’en ai curieusement rien retenu (il m’arrive, parfois, d’oublier complètement certains livres lus trop vite).
Quant à Chaos, son second roman (Grasset, 1997) (correctement résumé ICI), le plus réussi des trois à mon goût, on dirait un véritable décalque de Roth, dans le bon sens du terme : un narrateur tiraillé par des questions d’identité, fasciné par des membres de sa famille aux tempéraments différents… Des règlements de compte tous azimuts (avec Serge Doubrovsky, notamment, présenté sous son vrai nom)… Des postures apparemment paradoxales mais s’expliquant par une histoire familiale refoulée (figure du juif trouvant des circonstances atténuantes au révisionnisme)… Des raffinements narratifs et des mises en abîme diverses, comme ce frère du narrateur ayant le même nom que l’auteur du livre lui-même… Le passage suivant est représentatif des ambiguïtés de Chaos. Le narrateur y fait part de ses impressions à la lecture du livre de Doubrovsky, et il est difficile de ne pas supposer que Marc Weitzmann se substitue en grande partie à son narrateur :
« Bien que toutes les critiques se soient concentrées sur l’aspect « chronique conjugale » du livre de Doubrovsky, ce que racontait Le livre brisé, en fait, ce n’était pas seulement la déchéance d’un couple, c’était aussi la liaison d’un Juif obsédé par ses souvenirs de l’Occupation, avec une Autrichienne, dont le grand-père avait été flic, le père, soldat de la Wehrmacht, et l’oncle, SS. Une Autrichienne qui, comme l’écrit mon cousin dans la reconstruction de l’éloge funèbre qu’il improvisa au cimetière, « souffrait dans son cœur, d’une souffrance très vive, très personnelle, du mal que son pays a fait aux juifs ». Que mon frère soit venu jouer les satellites mondains, autour de ce drame, dix ans avant de basculer dans le révisionnisme, me semblait tout sauf anodin.
(…) Un chef-d’œuvre d’ambiguïté. Ce qui se présentait comme un éloge de la prise de conscience pouvait être lu, en sous-main, comme l’aveu d’une liaison sadique, basée sur une effrayante culpabilité intime. « Bien qu’elle ne fût pas née à l’époque, continuait-il, elle se sentait responsable des crimes de ses compatriotes, le passé de sa terre natale était pour elle un cruel tourment. » » (Chaos, Folio, page 151)
Cet exercice de style, parfaitement réussi, s’achève cependant sur une fin trop pathétique pour être vraiment crédible (le narrateur part vivre dans un quartier exagérément dangereux du Brésil), alors que Roth préfère achever ses romans, lui, sur des chapitres en suspension, des semi-fins pleines de mystère, décevantes parfois mais qui ont le mérite de préserver après la lecture un peu de la tension ressentie par le lecteur.