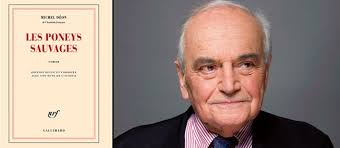mardi 24 octobre 2017
Le coeur incandescent de la littérature
Par admin, mardi 24 octobre 2017 à 11:37 :: Littérature française
Parfois, c’est un passage qui paraît détenir l’esprit de l’ouvrage, en proposer le sens secret, quitte à ce que le reste du livre s’engloutisse dans ces quelques mots.
Parfois, et l’un n’est pas exclusif de l’autre, c’est un passage simplement plus dense, éclipsant en partie les pages adjacentes. C’est par exemple ce que j’ai ressenti en lisant le beau livre de Victor Pouchet, qui se taille un joli succès en ce moment : Comment les oiseaux meurent. Trois pages se détachent à mes yeux, celles qui dressent le portrait du père en « beau parleur fatigué, qui n’avait jamais osé se révolter contre lui-même et son abyssale tristesse. » (Finitude, page 49-51). Et c’est ce passage grave qui me fait l’effet d’une tache de couleur très vive à côté de laquelle les pérégrinations pourtant cocasses du narrateur perdent un peu en relief.
Sans doute mon impression est-elle d’ailleurs accentuée par la propre structure de deux de mes livres. Dans Suicide Girls et dans Les petits Blancs, je consacre une page à mon père (pas la même dans chacun des deux) et celle-ci me paraît si déterminante que si le reste devait disparaître, cela m’attristerait à peine si je pouvais garder celle-là. A propos des Petits Blancs, quelques journalistes ne s’y sont pas trompés, me posant rapidement des questions à propos de cette sorte de vision centrale. C’était à mes yeux la preuve qu’ils avaient réellement lu le livre.