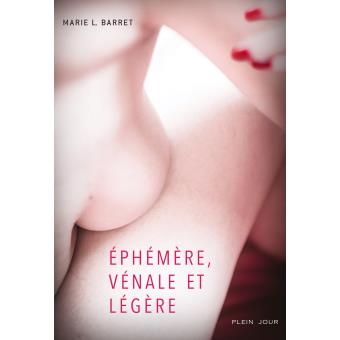En bon bobo, j'achète maintenant chaque dimanche matin mes produits frais sur le marché à deux pas de chez moi. Je m'essaye à la cuisine traditionnelle française, à la cuisine italienne, à la cuisine japonaise... Et pour le choix des recettes, je fonctionne de la manière suivante : quand je pense avoir épuisé les recettes qui me plaisent dans tel livre, je jette mon dévolu sur un autre dont les photos, le texte, l'esprit me plaisent - démarche tout à fait banale et néanmoins relativement maniaque.
A ce propos je viens de trouver le livre qui m'accompagnera quelques mois, et c'est un livre singulier car il relève en fait de l'essai littéraire. Dans
Houellebecq aux fourneaux, Jean-Marc Quaranta dresse un panorama très complet des références culinaires dans l'œuvre de Houellebecq, analysant leur fonction narrative et leur dimension sociologique - ce qui est inattendu puisque, comme l'auteur le souligne lui-même, on a surtout retenu des personnages de Houellebecq leur goût pour l'alcool et la cigarette.
J'hésite encore entre les chiripons au riz crémeux et la croustade landaise - mettant délibérément de côté les raviolis, auxquels je n'ai jamais réussi à donner de forme convenable. Pourtant ces mêmes raviolis donnent lieu à l'un des passages les plus drôles du livre:
"(...) Allant de désirs frustrés en échecs sexuels, Bruno est hanté par des raviolis et des cauchemars, au propre et au figuré. Au figuré, quand, après une soirée dansante calamiteuse, il se console avec "des raviolis en boîte sous sa tente". Au propre, quand, après avoir acheté "des raviolis en boîte" au Leclerc de Cholet, il fait, à son tour, un cauchemar. "Il se voyait sous les traits d'un jeune porc aux chairs dodues et glabres. Avec ses compagnons porcins il était entraîné dans un tunnel énorme et obscur, aux parois rouillées, en forme de vortex." Avec ses compagnons d'infortune, il sera déchiqueté et le crâne coupé en deux; toujours conscient et observant le monde de son œil unique, il pourra contempler sa fin et celle du monde. Manifestement, la cuisine italienne passe mal chez les deux frères." (page 82)