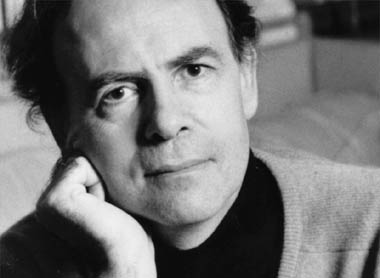samedi 5 avril 2008
Sophocle Vs Cocteau : Victoire de Sophocle par KO dès le premier round
Par admin, samedi 5 avril 2008 à 10:44 :: Littérature française

A deux classes j'ai fait lire en parallèle la pièce de Jean Cocteau, La Machine Infernale, reprenant de manière fantaisiste le mythe d'Oedipe, et de larges extraits de la pièce originelle, Oedipe Roi de Sophocle. Les élèves eux-mêmes ont admis que celle de Cocteau faisait pâle figure... Si l'on excepte certains passages assez gracieux, imprégnés d'une poésie désuette mais délicate, et certains autres qui font sourire, tout le reste est assez confus (lorsqu'il n'est pas emprunté à Sophocle).
Cocteau a beau jeu de faire valoir qu'il modernise le propos et qu'il le complexifie, montrant par exemple que les dieux eux-mêmes sont le jouet de dieux encore supérieurs à eux... Ce genre de circonvolution paraît tellement dérisoire par rapport à la force majestueuse du poète grec !
La pièce de Sophocle est courte et parfaitement maîtrisée, réglée comme une implacable machinerie policière (Oedipe mène l'enquête qui révélera aux yeux de tous l'ampleur de sa déchéance...). La langue est belle et simple, portée par un véritable souffle épique. Cocteau donne l'impression d'un gamin capricieux venant piétiner les plates-bandes des génies qui l'ont précédé.
"LE CORYPHEE : Regardez, habitants de Thèbes, ma patrie. Le voilà, cet Oedipe, cet expert en énigmes fameuses, qui était devenu le premier des humains. Personne dans sa ville ne pouvait contempler son destin sans envie. Aujourd'hui, dans quel flot d'effrayante misère est-il précipité ! C'est donc ce dernier jour qu'il faut, pour un mortel, toujours considérer. Gardons-nous d'appeler jamais un homme heureux, avant qu'il ait franchi le terme de sa vie sans avoir subi un chagrin." (Sophocle, Oedipe Roi)
"LA VOIX DE JOCASTE : A quoi sert d'être devin, je demande ! Vous ne savez même pas où se trouvent les escaliers. Je vais me casser une jambe ! Ce sera votre faute, Zizi, votre faute, comme toujours.
TIRESIAS : Mes yeux de chair s'éteignent au bénéfice d'un oeil intérieur, d'un oeil qui rend d'autres services que de compter les marches d'un escalier.
JOCASTE : Le voilà vexé avec son oeil ! Là ! Là ! On vous aime, Zizi; mais les escaliers me rendent folle. Il fallait venir, zizi, il le fallait !" (Cocteau, La Machine Infernale)