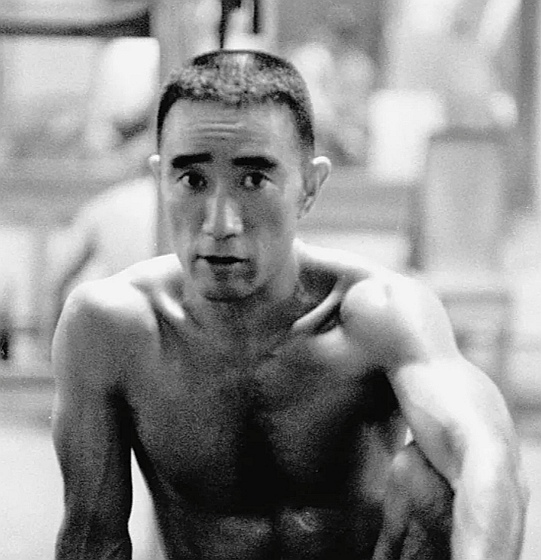lundi 14 septembre 2020
Homosexuels, fascistes et Gilets jaunes
Par admin, lundi 14 septembre 2020 à 10:20 :: Littérature française
A propos de « fascisme homosexuel », je me m’y étais intéressé voilà quelques années, proposant même à l’un de mes éditeurs de me lancer dans l’écriture d’un roman sur ce thème. « Malheureux ! m’avait-il répondu. Tu vas te mettre à dos toute la communauté gay, ce sera terrible. » J’avais pourtant en tête de sérieuses références, puisque je venais de lire de magnifiques livres de Mishima fantasmant des corps de métal et des morales d’acier, sur fond d’amours homosexuelles. Tom Connan vient de déflorer le thème sur le sol romanesque français.
« Nous nous étions réfugiés avec Simon à La Palette, un bar de la rue de Seine qui fermait tard.
En début de soirée, nous avions été voir l’interminable film Magnolia, avec un Tom Cruise plus improbable que jamais, dans un petit cinéma proche de la rue Soufflot qui ne passait que des vieilles pellicules. Il était 23 heures et nous n’avions toujours pas dîné.
« Alors, comment ça se passe, ton bouquin ? Tu avances sur tes mecs de droite ? demandai-je, sourire en coin.
- Ouais, ça avance, de toute façon l’intuition est là, il faut juste que je la mette en forme, mais je sens que c’est la bonne piste. D’ailleurs, on voit qu’il y a une colère de dingue qui monte, et pour une fois elle vient du peuple profond. Pas des lycéens des beaux quartiers ou des profs.
- Ouais… Mais en quoi ça confirme ton hypothèse ?
- Bah, ça me paraît évident ! Le peuple profond, il est carrément de droite. Plutôt blanc, de culture catho et avec de vieux relents xénophobes… La France de Pernaut, quoi ! Ceux qui manifestent tous les samedis. » » (Radical, page 91)