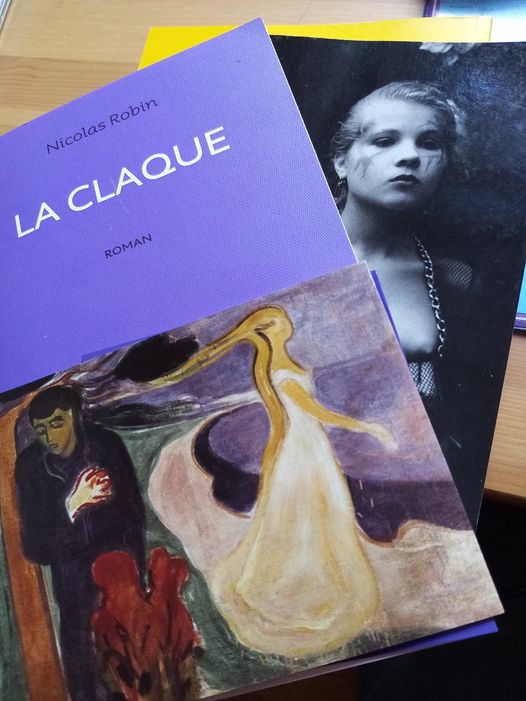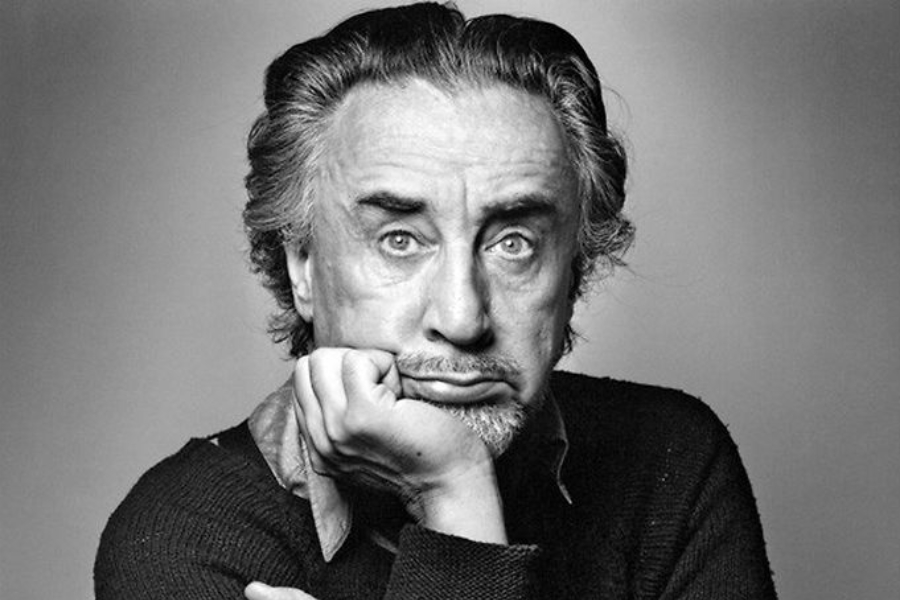Le prénom Aymeric connaît un certain regain d’intérêt chez les romanciers. Et les deux dernières occurrences à ma connaissance ont le don de me faire sourire. Houellebecq propose un personnage d’aristocrate dépressif dans « Sérotonine » (Flammarion, 2019), renonçant à sa carrière d’ingénieur pour devenir agriculteur et manifestant sa colère jusqu’au sacrifice. A l’inverse, on découvre chez Bruno Lafourcade dans son roman pamphlétaire « L’Ivraie » (Léo Scheer, 2019) un professeur singulièrement ridicule par son impatience à « faire jeune ». Le conservateur contrarié d’un côté, l’épouvantable progressiste de l’autre… J’aime l’idée que ce prénom cristallise des fantasmes aussi variés.
« « Déjà, moi, lui avait dit devant la machine à café un certain Aymeric, un jeune professeur de français coiffé d’une casquette rouge et d’un tee-shirt qui laissait voir, à la naissance du coup, un tatouage où se croisaient des pointes en forme de virgules, de cornes, de faux, je leur fais un speech sur le respect et tout, genre : on est là pour faire du bon boulot tous ensemble, alors ceux qui sont pas là pour bosser, je veux pas les entendre… Comme ça, pendant dix minutes. Crois-moi, ça sera pas du temps perdu. » » (L’Ivraie, p. 55).
« « J’ai un droit de garde, évidemment, mais en pratique elles sont à Londres, ça fait deux ans que je ne les ai pas vues ; qu’est-ce que tu veux que je fasse, ici, avec deux petites filles de cinq et sept ans ? »
Je jetai un regard sur la salle à manger, les boîtes de cassoulet et de cannellonis éventrées qui jonchaient le sol, l’armoire abattue qui laissait échapper une vaisselle de porcelaine en miettes (et c’était probablement Aymeric lui-même qui avait renversé cette armoire, au cours d’une crise de rage éthylique) ; en effet, on ne pouvait pas lui donner tort, c’est étonnant à quel point les hommes se laissent sombrer rapidement. J’avais remarqué la veille que les vêtements d’Aymeric étaient franchement sales, et même qu’ils puaient un peu : déjà, à l’Agro, il ramenait son linge à laver à sa mère tous les week-ends, enfin moi aussi mais quand même j’avais appris à faire fonctionner les machines mises à disposition des étudiants dans le sous-sol de la résidence, et je l’avais fait deux ou trois fois, lui jamais, il n’en avait même pas soupçonné l’existence je crois. Peut-être en effet est-ce qu’il valait mieux laisser tomber, pour les petites filles, et se concentrer sur l’essentiel, après tout des petites filles il pourrait en refaire d’autres. » (Sérotonine, p. 207).