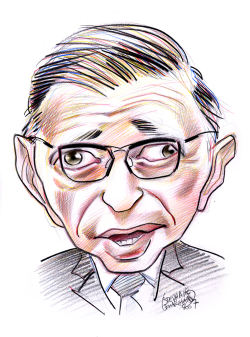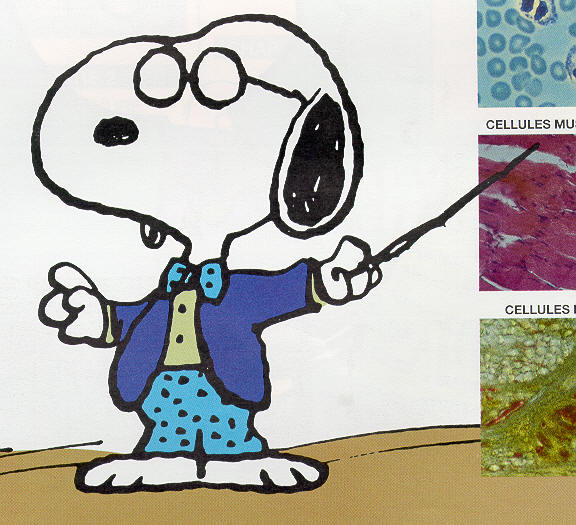»

Les essais, pamphlets, témoignages, vieillissent mal en général.
Et puis il y en a qui restent et même brillent d’un éclat particulier, avant de devenir légendaires. C’est le cas de la merveilleuse
Etrange défaite, de
Marc Bloch. Elle se distingue par sa clarté, son intelligence, sa beauté, mais aussi par la personnalité exceptionnelle de l’auteur : courageux jusqu’au sacrifice, fin moraliste, brillant pamphlétaire, modeste qui plus est.
Résistant de la première heure, intellectuel ayant su prendre de véritables risques (et les ayant payé de sa vie), Marc Bloch jette une ombre singulière, je trouve, sur la gloire de certaines autres figures d’intellectuels prompts, eux, à donner des leçons mais beaucoup moins vaillants dans les faits.
Dans les premières pages de ce témoignage, écrit en 1940, sur la débâcle de la même année, Marc Bloch livre une page redoutablement belle sur ses valeurs et son identité, une page émouvante à lire aujourd’hui pour ses multiples échos avec les brûlants débats d’aujourd’hui – et pas seulement sur la question de l’antisémitisme. La petite fille de Marc Bloch s’est d’ailleurs offusquée récemment que Sarkozy puisse instrumentaliser ce genre de texte, pour en changer, dit-elle, le sens profond.
Certains s’élèvent d’autre part contre la figure du « Juif franco-judaïque » qu’incarnait alors Marc Bloch par ce genre de page, le genre de Juif, nous explique
Bernard-Henri Lévy dans son
Génie du Judaïsme (chapitre inclus dans son volume
Pièces d’identité), à « raboter tout ce qui pouvait rappeler, trahir, le judaïsme en lui », marque d’un « judaïsme peureux, obsédé par la peur de créer ou faire renaître l’antisémitisme, presque honteux. » (page 247)
Cette page d’une actualité brûlante, donc, cette page à laquelle on continue à faire référence pour la revendiquer ou pour s’en moquer, est la suivante :
«
Je suis Juif, sinon par la religion, que je ne pratique point, non plus que nulle autre, du moins par la naissance. Je n’en tire ni orgueil ni honte, étant, je l’espère, assez bon historien pour n’ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe et la notion même de race pure une absurdité particulièrement flagrante, lorsqu’elle prétend s’appliquer, comme ici, à ce qui fut, en réalité, un groupe de croyants, recrutés, jadis, dans tout le monde méditerranéen, turco-khazar et slave. Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas : en face d’un antisémite. Mais peut-être les personnes qui s’opposeront à mon témoignage chercheront-elles à le ruiner en me traitant de « métèque ». Je leur répondrai, sans plus, que mon arrière-grand-père fut soldat, en 93 ; que mon père, en 1870, servit dans Strasbourg assiégé ; que mes deux oncles et lui quittèrent volontairement leur Alsace natale, après son annexion au IIè Reich ; que j’ai été élevé dans le culte de ces traditions patriotiques, dont les Israélites de l’exode alsacien furent toujours les plus fervents mainteneurs ; que la France, enfin, dont certains conspireraient volontiers à m’expulser aujourd’hui et peut-être (qui sait ?) y réussiront, demeurera, quoi qu’il arrive, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J’y suis né, j’ai bu aux sources de sa culture, j’ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel, et je me suis efforcé, à mon tour, de la défendre de mon mieux. »
La suite du texte livre de fines analyses de la défaite (conçue comme le résultat d’une somme de faiblesses particulières) et réserve plusieurs phrases devenues des références : « C’est un pauvre cœur que celui auquel il est interdit de renfermer plus d’une tendresse » (à propos de l’amour conjugué de l’internationalisme et de la patrie) ; « Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l’histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims ; ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. » (Phrase récitée plusieurs fois par Sarkozy).
Zemmour Nolleau BHL Le genie du judaisme 1/2... par walpisnakepriest
Sans parler d’un beau texte, dans le même volume, intitulé « Pourquoi je suis républicain », assénant ses principes avec force et sérénité dans un contexte de résistance à l’occupant nazi. Difficile de ne pas adhérer à ce genre de passage, à l’heure où il devient de bon ton, parfois, de se moquer de la notion même de République :
«
La cité étant au service des personnes, le pouvoir doit reposer sur leur confiance et s’efforcer de la maintenir par un contact permanent avec l’opinion. Sans doute cette opinion peut-elle, doit-elle être guidée, mais elle ne doit être ni violentée ni dupée, et c’est en faisant appel à sa raison que le chef doit déterminer en elle la conviction. »
(…)
«
Qu’on le veuille ou non, la monarchie a pris aux yeux de toute la France une signification précise. Elle est comme tout régime, le régime de ses partisans, le régime de ces Français qui ne poursuivent la victoire que contre la France, qui veulent se distinguer de leurs compatriotes et exercer sur eux une véritable domination. (…) La République, au contraire, apparaît aux Français comme le régime de tous, elle est la grande idée qui dans toutes les causes nationales a exalté les sentiments du peuple. C’est elle qui en 1793 a chassé l’invasion menaçante, elle qui en 1870 a galvanisé contre l’ennemi le sentiment français, c’est elle qui, de 1914 à 1918, a su maintenir pendant quatre ans, à travers les plus dures épreuves, l’unanimité française ; ses gloires sont celles de notre peuple et ses défaites sont nos douleurs.